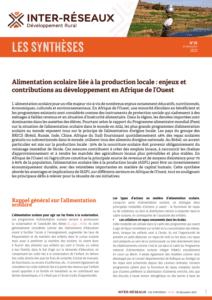Entretien avec Michel Petit, réalisé par téléphone le 7 mai 2008 (petitmichel@free.fr)
Grain de sel : Depuis quelques semaines, la question de la relance de l’agriculture est partout à l’ordre du jour. Les pays en développement aurontils demain plus qu’hier les moyens de mettre en oeuvre des politiques agricoles volontaristes ?
Michel Petit : Le mot clé est dans votre question, vous venez de le prononcer : « volontarisme ». Selon moi, les pays en développement auront les moyens s’ils se les donnent. Cela dépend beaucoup de leur volonté. Si l’agriculture a été négligée dans le développement ces dernières années, cela vient d’un « biais urbain » ¹ qui n’est pas le fait des bailleurs de fonds mais plutôt des gouvernements des pays en développement. On a encore pu vérifier cette thèse récemment avec la hausse des prix alimentaires : les États ont tout de suite réagi face aux manifestations de consommateurs. Alors que rien n’avait été fait depuis bien longtemps devant la pauvreté, la faim et la souffrance de paysans ne se rebellant pas. Le problème majeur de l’aide c’est la relation entre les bailleurs de fonds et les autorités publiques des pays en développement. Les priorités de l’aide sont décidées dans des réunions communes où les États disent leurs priorités. Ce sont donc les interactions bailleurs-États qu’il faut blâmer. La Banque mondiale affirme vouloir lutter contre la pauvreté dans les zones rurales ? Mais si les clients ne disent pas que c’est une priorité, elle n’en fait pas sa priorité.
GDS : Les pays africains se sont engagés à consacrer 10% de leur budget au secteur agricole. Pourtant ils n’y parviennent pas. Qu’est-ce qui pourrait changer la donne budgétaire ?
MP : La déclaration des pays africains de vouloir consacrer 10% de leurs budgets à l’agriculture est en soi une bonne chose, c’est le signe d’une prise de conscience de leur part que, jusqu’à présent, il y a eu négligence. L’agriculture, tout comme le développement rural, sont deux secteurs négligés par les mêmes déterminants politiques. Cela étant dit, il y a des difficultés objectives à surmonter dans ces secteurs. Il n’est pas facile de trouver les bons investissements dans l’agriculture. Les gouvernements comme les bailleurs de fonds ont connu une série d’échecs par le passé. Par exemple, la Banque mondiale a longtemps financé des projets de développement rural intégré dont beaucoup ont été des échecs. Ces programmes, reconnaissant les interrelations importantes entre secteurs et promouvant des actions intersectorielles, nécessitaient une gouvernance infranationale (régionale) qui, en réalité, n’existait pas. La Banque mondiale a également inventé et propagé le système « Training and Visit » ² en matière de vulgarisation agricole. Ce système, très critiqué à juste titre par les Français il y a quinze ou vingt ans, est désormais abandonné. Le diagnostic fondant la méthode n’était peut-être pas mauvais, mais les moyens mis en oeuvre n’étaient pas appropriés eu égard à l’ampleur des difficultés à surmonter.
Les ressources financières sont nécessaires, mais il faut aussi les bonnes pistes pour dépenser cet argent. Parmi ces pistes, l’émergence d’organisations de producteurs au cours des vingt dernières années doit être suivie avec attention. Il faut aussi soutenir le développement des filières. Dans ce domaine, des organisations ont été démantelées — Fonds monétaire international et Banque mondiale ont leur part de responsabilité dans ce démantèlement — il faut les reconstruire. La recherche agronomique se trouve dans une situation catastrophique dans de nombreux pays. Il faut relancer les institutions publiques de recherche. Cela coûtera cher et prendra du temps.
GDS : Que peut faire raisonnablement l’aide au développement dans le dispositif global de financement du secteur et des politiques agricoles?
MP : Il est nécessaire de partir de la situation des agriculteurs. Beaucoup font des cultures de subsistance, sur des exploitations de petite taille, sans ressources, avec une tenure (foncier) précaire. Dans ces conditions, la modernisation et l’intensification sont difficiles. L’Inde a réussi à soutenir efficacement ce type d’agriculture pendant au moins deux décennies. Cela a pris du temps, mais elle y est parvenue. Peutêtre a-t-elle disposé d’un « avantage » du fait d’une pression démographique forte. Je m’explique : elle a dû intensifier à tout prix, tandis qu’en Afrique, des terres sont disponibles. Au cours des dernières années la production totale a ainsi certes augmenté de façon significative, mais cette augmentation n’est pas due à l’intensification, elle est due à l’extension des surfaces cultivées. De tels processus risquent à terme d’avoir des conséquences environnementales sérieuses. Il faudra donc intensifier à l’avenir et le financement de l’agriculture devra faciliter cette intensification. Il faut donc appuyer la réforme des organes de financement, crédit mutuel, microfinance (les IMF même si elles ne sont pas la panacée — elles sont plus efficaces dans les activités artisanales où les taux de rotation sont plus importants que dans l’agriculture — sont importantes). Il y a des pistes prometteuses pour le financement de la petite agriculture paysanne. La communauté internationale doit y être attentive, car elle peut aider beaucoup. Par ailleurs, le grand procès de l’aide publique au développement en France n’a peut-être pas été très juste. Les nombreux coopérants techniques basés en Afrique de l’Ouest avaient peut-être mauvaise presse, mais ils représentaient un capital de connaissance considérable. Avec la disparition du ministère de la Coopération, ce capital a été démantelé et cette culture s’est perdue. Lorsque j’étais à la Banque mondiale, le dialogue avec les Coopérants français était vif et utile. Il faut reconstruire cette capacité. Les euros sont indispensables, mais je le répète, une intelligence est tout aussi indispensable, pour appuyer tant les acteurs publics que les OP et le secteur privé.
GDS : Quelles sont les pistes autour desquelles repenser le financement de l’agriculture ? La rentabilité de l’agriculture offre-t-elle de réelles perspectives à l’investissement privé ? Est-ce compatible avec la promotion de l’agriculture familiale ?
MP : Voilà une bonne mais difficile question. Il existe un large consensus. Personne ne recommande de grandes plantations et un modèle capitaliste de l’agriculture en Afrique. Il est évident qu’un tel modèle ne résoudrait pas les problèmes d’emploi et de pauvreté de centaines de millions de familles.
La question c’est de savoir comment aider des centaines de millions d’acteurs à s’engager peu ou prou dans l’économie de marché. Avant tout il faut prendre en compte la diversité des situations. Selon les pays, les lieux, les filières, les conditions sont très variées : un producteur de coton du Mali n’a pas les mêmes difficultés qu’un maraîcher péri-urbain au Sénégal ou un éleveur du Niger.
On ne peut résoudre la question du financement sans savoir ce qu’on va financer. Par exemple dans les filières : l’approvisionnement en intrants, la circulation de l’information et des connaissances ; il faut trouver des solutions appropriées et appuyer les bonnes institutions pour les mettre en oeuvre.
GDS : Les nouveaux besoins de financement de la relance agricole vont-ils remettre en cause la libéralisation du commerce ? Faut-il repenser la fiscalité du secteur agricole pour assurer une forme de financement via la redistribution au sein du secteur ?
MP : Je ne crois pas que la libéralisation soit le principal obstacle auquel les agricultures africaines sont confrontées. Il y a certes des situations où c’est le cas. On a vu les problèmes rencontrés par le secteur avicole au Sénégal notamment, les aviculteurs locaux ayant du mal à lutter contre des importations de morceaux de poulet venant des États-Unis. Dans le même ordre d’idées, l’Europe a subventionné ses exportations de viande bovine qui, arrivant dans les ports de la côte ouest africaine, était moins chère que la viande sahélienne. Mais il ne faut pas généraliser. D’ailleurs les subventions aux exportations sont contraires aux principes de la libéralisation. Plusieurs faits doivent être pris en compte pour éclairer le débat relatif à la libéralisation : – les engagements des pays africains vis-à-vis de l’OMC à baisser leurs barrières douanières sont faibles. Il reste des moyens de protection tarifaire importants ; – le relèvement des tarifs communs des communautés économiques régionales ne devrait pas être politiquement très difficile puisque les tarifs potentiels à l’OMC restent élevés. En outre, les pays les moins développés n’auront pas beaucoup d’efforts à faire lors de la relance du cycle de Doha ; – l’agriculture africaine bénéficie d’une protection naturelle. Le manque d’infrastructures, le mauvais fonctionnement des marchés, la cherté des engrais sont des problèmes plus graves que l’ouverture des marchés.
Je suis bien conscient que mon point de vue n’est pas le point de vue dominant, mais néanmoins à ce jour c’est ce que je crois.
Pour ce qui concerne la fiscalité, je ne pense pas que repenser la fiscalité pour redistribuer les revenus à l’intérieur du secteur agricole soit la priorité. S’il y a des réformes à faire, il faudrait supprimer ou tout au moins réduire les taxes aux exportations, qui ont fortement pénalisé l’agriculture. Pour ce qui concerne la redistribution au sein du secteur, je n’y crois pas. Étant donné la faible capacité contributive des autres secteurs, je suis perplexe. Pour financer des actions au bénéfice des agriculteurs et des populations rurales, il faut mettre l’APD sur ces actions.
GDS : La Banque mondiale, en consacrant son rapport sur le développement dans le monde 2008 à l’agriculture, a fait une forme de mea culpa. Que faut-il retenir de cette rétrospective ? Quel devrait être le rôle de la Banque et autour de quelles idées forces devrait- elle repenser ses appuis au secteur agricole ?
MP : Mon message principal tient dans une question : pourquoi la Banque mondiale n’a-t-elle pas fait ce qu’elle dit depuis 15 ans ? En effet, le WDR — malgré les nombreux commentaires qu’il a suscités — ne représente pas une rupture. Il y a quinze ans, la Banque disait la même chose. Mais elle n’a pas fait ce qu’elle a dit… depuis ans. Selon moi, il est nécessaire de revoir le système d’incitation et de promotion à l’intérieur de la Banque mondiale. Les départements géographiques — jusque là en charge de la mise en oeuvre des projets — n’étaient pas suffisamment incités à travailler avec le milieu rural — un travail difficile et souvent plus ingrat que dans les secteurs de l’éducation ou de la santé.
Michel Petit est ingénieur agronome, économiste. Enseignant à l’Enesad (Dijon) à ses débuts, il a ensuite travaillé en Inde pour la fondation Ford, avant de rejoindre la Banque mondiale (BM), en 1988. Il est resté 10 ans à Washington pour la BM, tout à tour directeur du département Agriculture et Développement rural puis responsable d’une unité multibailleurs de fonds travaillant sur le soutien à la recherche au niveau mondial. Ses premiers travaux sur les politiques agricoles (dans les années 80) ont consisté en une comparaison des politiques agricoles de l’Union européenne et des Etats-Unis.