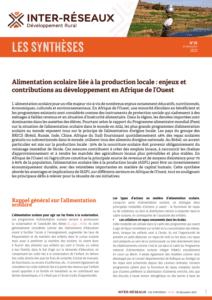_
Il ne saurait y avoir de définition universelle permettant de caractériser la politique agricole. Toute définition dépend en premier lieu du contexte historique en fonction des idées dominantes du moment. Tenter de définir une politique agricole aujourd’hui, alors qu’existent de fortes pressions internationales pour démanteler les dispositifs de soutien en matière d’agriculture, n’est pas le même exercice qu’il y 30 ans, quand l’intervention publique était légitime par elle-même et n’avait pas besoin d’être justifiée. Toute définition dépend également du contexte culturel. Les Anglo-saxons n’ont pas la même perception de la politique agricole que les Francophones : ces derniers ont une approche plus volontariste et interventionniste, les premiers en ont une approche plus libérale.
Il existe donc dans la littérature plusieurs définitions qui dépendent de l’angle selon lequel on se place. T. Pouch propose ainsi plusieurs définitions de la politique agricole, chacune correspondant à un point de vue particulier. La politique agricole est tour à tour (i) « un mode d’allocation des ressources plus efficace que le marché » si l’on met en avant l’existence de défaillances de marché et le besoin de les corriger, (ii) « un système social visant à préserver les intérêts de certaines catégories de la population ou groupes de pression » si l’on se place du point de vue de l’économie politique, (iii) « un ensemble de moyens permettant aux agriculteurs de préserver ou d’étendre leur compétitivité interne et externe et de dégager des parts de marché au détriment de leurs principaux concurrents » si l’on privilégie une approche en termes d’économie internationale.
Politique agricole : une réalité complexe. Tout en prenant acte de cette complexité, on se contentera ici de reprendre la définition qui fait le plus largement consensus et qui associe la politique agricole à un ensemble de mesures dirigées vers le secteur agricole. Plus précisément, une politique agricole est « un ensemble de mesures réglementaires, dispositifs structurels, moyens financiers et humains interdépendants, mis en oeuvre par la puissance publique pour contribuer à la progression du secteur agricole ». L’incidence des mesures de politique générale (fiscale et monétaire par exemple) doit également être prise en compte au titre de l’intervention publique dans le secteur agricole.
Cette définition, apparemment assez neutre car privilégiant une approche instrumentale, repose en fait sur plusieurs hypothèses implicites : – la première est que les différentes mesures considérées sont cohérentes entre elles ; cette cohérence est en général assurée par la référence commune à des objectifs préétablis : les différentes mesures convergent toutes vers l’atteinte de ces objectifs. Cette hypothèse conduit à la séquence linéaire suivante : en premier lieu, formulation des objectifs de la politique, puis identification des mesures destinées à les atteindre, et enfin mise en oeuvre de ces mesures. Cette séquence vertueuse permet une bonne cohérence entre la conception de la politique et sa mise en oeuvre ; – la seconde hypothèse implicite est l’unicité de décision tout au long du processus de politique agricole : le même groupe de personnes intervient du début à la fin du processus, ou, s’il existe différents intervenants, il y a bonne coordination entre eux ; – la troisième hypothèse porte sur la soutenabilité financière des mesures : il existe des moyens permettant de mettre en oeuvre ces mesures. Il n’y a pas de rupture dans le financement, de manière à ce que la politique s’inscrive dans la durée (idée de stabilité et de lisibilité de la politique).
Ces différentes hypothèses implicites confèrent à la définition de la politique agricole un caractère normatif de ce que devrait être une bonne politique : dotée d’objectifs en lien avec un projet de société et d’instruments stables dans la durée permettant d’atteindre ces objectifs. En pratique, ces hypothèses sont loin d’être vérifiées dans tous les contextes nationaux. Elles ne le sont notamment pas dans bon nombre de pays africains du fait de situations institutionnelles spécifiques : – il y a rarement unicité de décision dans les processus de politique agricole à travers le monde. Cette multiplicité des centres de décision se vérifie bien souvent en Afrique subsaharienne du fait des interférences États/bailleurs de fonds qui génèrent un paysage institutionnel complexe duquel n’émerge aucun leadership clair ; – il y a généralement une dichotomie forte entre ceux qui définissent les orientations de la politique agricole (les services ministériels) et ceux qui financent les actions (les bailleurs internationaux). En découle logiquement un écart important entre ce qui est annoncé et ce qui est réalisé, qui pourrait apparaître en première instance comme un déficit de cohérence ; – le manque de financements inscrits dans la durée est une autre limitation. D’une manière générale, les États ne disposent pas des budgets qui permettraient de mettre en oeuvre la politique. Les actions peuvent alors être remises en cause à courte échéance. De récents efforts ont été entrepris pour doter les politiques de moyens pérennes, comme la création du Fonds de développement agricole (FDA) de la Politique agricole de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), la PAU. Mais les financements mobilisés restent nettement insuffisants.
Des intentions aux actions. Pour ces différentes raisons, la définition initiale de la politique agricole n’est pas pertinente pour les pays africains et il n’est pas possible avec ce seul terme de faire référence simultanément au processus dans son ensemble, aux objectifs, aux mesures prises et aux moyens affectés. Il en découle une utilisation différente du terme de politique agricole selon les interlocuteurs, qui évoquent l’un ou l’autre de ces aspects à l’exclusion des autres. Bien que plusieurs interprétations du terme existent, deux d’entre elles sont le plus fréquemment reprises : – la première consiste à parler de la politique agricole en se référant avant tout aux intentions, c’est-à-dire en évoquant les textes d’orientations et les objectifs généraux, même si ceux ci ne sont pas mis en œuvre. Cette démarche, plutôt volontariste, tend à faire passer la politique agricole pour ce qu’on voudrait qu’elle soit plutôt que pour ce qu’elle est réellement ; – la deuxième approche, plus réaliste, consiste à appréhender la politique agricole comme l’ensemble des actions effectivement mises en oeuvre dans le secteur agricole. La difficulté pratique vient alors du fait que cet ensemble d’actions est le plus souvent hétérogène (parce qu’il est conduit par un grand nombre d’acteurs) et qu’il est en conséquence difficile d’en faire ressortir la cohérence. Le recensement des différents projets s’apparente à une compilation d’actions superposées qu’il n’est pas aisé de relier à un quelconque objectif commun : à titre d’exemple, au Burkina Faso, l’Union européenne et les différents pays membres de l’UE ont bien cherché à coordonner leurs interventions dans le cadre de Plans d’actions par filière, mais cela n’empêche aucunement la Banque mondiale, la Coopération chinoise et des Fonds arabes d’intervenir dans ces mêmes filières sans se référer aux Plans d’actions élaborés avec l’appui des Européens.
Les contextes institutionnels de nombreux pays africains renvoient de la notion de politique agricole une vision polymorphe qui peut prêter à confusion si chacun ne prend pas soin de préciser sa propre définition du terme. Le jeu complexe des acteurs nationaux et internationaux, le manque de capacité budgétaire des États à financer eux-mêmes les mesures, le fait que ces mesures ne soient pas inscrites dans la durée mais puissent être remises en cause à brève échéance, l’absence de consensus sur un projet d’avenir pour les agricultures nationales, sont autant de facteurs contribuant à rendre peu lisibles les politiques agricoles.
Vers des politiques agricoles « réappropriées » ? À long terme, des évolutions à l’oeuvre dans ces pays pourraient toutefois amener à une convergence des différentes acceptions du terme « politique agricole » en faisant se rapprocher progressivement les déclarations d’intention et les actions effectivement mises en oeuvre. Des signes d’une volonté de réappropriation du politique par les pouvoirs publics apparaissent dans divers pays africains. Ils se manifestent notamment par la mise en oeuvre de processus participatifs d’élaboration de Lois d’orientation agricole (LOA), comme au Sénégal et au Mali, en rupture avec les pratiques qui prévalaient jusqu’alors. Les Organisations de producteurs (OP) ont progressivement accru leur capacité à peser dans les débats de politique agricole de divers pays. Elles portent en elles une double exigence de clarification des choix de développement agricole et de mise en adéquation des moyens pour que ces choix se traduisent concrètement en actions. Ces différentes évolutions sont certes lentes et demandent du temps pour avoir des répercussions visibles sur les processus de politique agricole. Elles contribuent néanmoins à réduire l’écart qui existe actuellement entre les différentes utilisations du concept de politique agricole.
Économiste à l’Unité mixte de recherche (UMR) Moïsa du département Environnements et Sociétés (ES) du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad), Vincent Ribier a publié divers articles et documents en lien avec les politiques agricoles. Il est notamment coauteur du Manuel d’élaboration des politiques agricoles ; construction d’argumentaires de l’intervention publique (Éditions du Gret, 2004, 160 p.) et de Renforcer les politiques publiques en Afrique de l’Ouest et du Centre : pourquoi et comment ? Notes et études économiques du ministère de l’Agriculture et de la Pêche, nº 28, septembre 2007, pp.45-73.