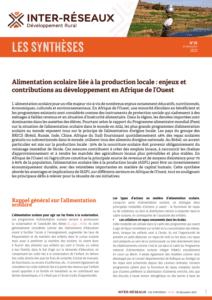Grain de sel : À l’heure de la globalisation et de l’intégration régionale, quelle est l’utilité des politiques agricoles nationales pour les États de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ?
Jean-Michel Debrat : Les politiques agricoles nationales comme régionales s’attachent à répondre à un même constat, qui est la place primordiale du secteur agricole dans l’économie des pays en développement. Un constat d’ailleurs rappelé avec force par le dernier rapport annuel de la Banque mondiale. Or les défis — économiques, écologiques et démographiques — auxquels est aujourd’hui confrontée l’agriculture africaine, appellent à une réflexion approfondie sur ces politiques agricoles et les différents cadres géographiques dans lesquelles elles s’inscrivent.
Les politiques nationales reposent sur les fonctions régaliennes. En matière agricole, elles prennent la forme de réglementations administratives, de conditions fiscales, de politiques foncières. Autant d’interventions étatiques qui ont une influence déterminante sur la productivité agricole, l’accroissement de la production, l’aménagement de l’espace et la gestion du capital naturel dans la durée.
Le niveau régional quant à lui devrait être plus à même de gérer l’offre et la demande de produits agricoles, par des infrastructures d’échange et la politique des marchés. Ainsi c’est au niveau régional que pourront être abaissés les droits de douane ou être mis en place un éventuel tarif extérieur commun. En outre certaines infrastructures, mêmes nationales, disposent d’un hinterland régional, tels les grands ports commerciaux. Enfin c’est également à l’échelle régionale que peuvent être définies de véritables politiques de filières permettant à certains produits de trouver leur place dans le marché mondial. Le prototype en est bien sûr la filière coton, en faveur de laquelle des mécanismes régionaux ambitieux pourraient voir le jour. On pourrait ainsi imaginer que la commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) prenne des responsabilités dans la gestion de cette filière coton, commune à beaucoup de ses ressortissants. Mais de nombreuses autres cultures vivrières produites dans différents pays d’une même région pourraient bénéficier de ce type de mécanismes communs.
Au-delà de l’opposition national/ régional, cadre traditionnel d’analyse des politiques agricoles, c’est en termes d’espaces de production et d’espaces de marché qu’il convient de raisonner. En effet, les divisions administratives ne rendent généralement pas compte de la réalité géographique des milieux naturels de production. Ce sont donc ces bassins de production et de commercialisation agricole qui doivent retenir notre analyse. Cette notion de « bassin de production » recoupe des réalités géographiques très différentes : si certaines productions sont marquées par leur caractère très local — telle la ceinture vivrière autour d’une ville — d’autres sont organisées à plus large échelle pour alimenter des marchés communs.
Cette approche zonale permet de mettre en exergue un bassin de commercialisation en plein développement : celui des villes africaines. En effet, ces dernières, qui connaissent un accroissement démographique sans précédent, constituent le premier marché potentiel des produits vivriers africains. La monétarisation des produits vivriers est donc une véritable chance de modernisation et de développement de l’agriculture africaine.
Ces différents espaces peuvent ainsi parfaitement s’emboîter sans s’opposer : les différentes échelles se croisent et se complètent.
Toutefois le niveau national garde dans bien des cas sa pertinence. Et c’est finalement un principe de subsidiarité qui doit fonder la coopération entre politiques agricoles nationales et régionales. Du fait des particularités de l’agriculture africaine (prépondérance des agricultures familiales, problème d’insertion des jeunes en milieu rural compte-tenu de l’accroissement démographique venant compenser l’exode rural, besoin de sécurisation des exploitants, nécessité d’une gestion intégrée des ressources naturelles), c’est en partant de l’échelon local — si possible décentralisé — et en remontant lorsque nécessaire vers l’échelon régional, que beaucoup de problèmes pourront être efficacement traités. L’agriculture africaine, qui offre encore des marges de productivité considérables, pourrait largement bénéficier de mesures très concrètes à l’échelon local.
GDS : L’intégration régionale représente- t-elle une véritable opportunité pour l’agriculture ? Comment les politiques agricoles pourraient-elles impulser de nouvelles dynamiques à l’échelle régionale dans un contexte de crise des politiques nationales ?
JMD : Revenons tout d’abord sur le sens de cette crise des politiques nationales. Si ces dernières ont pour finalité de répondre aux chocs externes, alors il ne fait aucun doute qu’elles n’ont pas la capacité d’action requise. Car dans la plupart des cas, les pays d’Afrique ne disposent pas des moyens budgétaires et administratifs nécessaires pour faire face à de tels aléas. En ce sens la notion de crise de politiques nationales traduit en réalité le fait que les États ne sont pas à l’échelle des problèmes qui leur sont posés. Et de ce point de vue la région semble effectivement mieux armée.
Toutefois il est certain que, dans bien des cas, les politiques nationales ne remplissent pas correctement le rôle qui pourtant est à leur portée : c’està- dire la mise en oeuvre d’une saine gouvernance, d’une politique foncière efficiente, d’une gestion efficace des communautés décentralisées ; toutes choses essentielles à la vie du monde rural. En ce sens beaucoup reste à faire au niveau national.
L’intégration régionale quant à elle vise à raisonner en termes de spécialisation des productions et de promotion des produits sur les marchés. Dans le contexte de mondialisation des échanges qui est le nôtre, il semble clair que le niveau régional est plus à même de répondre à ces défis et de disposer d’une vision claire et ambitieuse en matière de politique agricole. Le niveau régional permet les circuits d’échange et les complémentarités, notamment des produits vivriers (céréaliers, d’élevage sur pied ou autre). La crise de hausse des prix agricoles que nous connaissons, conjuguée à la tendance de la démographie africaine, autorise donc à penser que le vrai marché des agriculteurs africains est celui des produits vivriers destinés aux marchés régionaux.
Enfin, il est essentiel pour les responsables africains de pouvoir peser dans les négociations commerciales internationales. Or cela passe nécessairement par une intégration régionale accrue. Car le défi est double pour les politiques commerciales africaines : d’une part les nations sont mal armées pour pouvoir les définir et les défendre au sein des instances internationales, notamment à l’OMC ; et d’autre part il n’existe pas de construction supranationale capable pour l’instant de gérer les défis actuels. Ce fut tout le drame de la négociation APE : l’absence de négociateurs régionaux a largement desservi les intérêts des pays concernés. Or ces derniers pourraient parler d’une seule voix en franchissant une étape supplémentaire dans le cadre des unions régionales. Si l’Uemoa dispose davantage de cette capacité, elle ne représente qu’une partie de la région dont nous parlons. La condition d’un dialogue solide et fructueux pour ces pays est donc de se constituer en bloc régional, assurant la promotion de politiques agricoles compatibles, et donc autant que possible coordonnées, et incluant toutes les parties prenantes (notamment la société civile locale).
Directeur général adjoint de l’Agence Française de Développement (AFD), Jean- Michel Debrat a été administrateur civil du ministère des Finances et conseiller budgétaire au cabinet du ministre de la Coopération et du Développement. J.-M. Debrat est agrégé de géographie et diplômé de l’École nationale d’Administration (Ena).