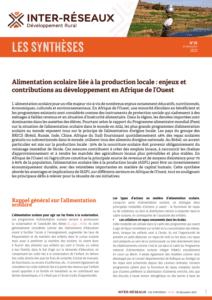Editorial
Gros sel
L’invité de Grain de sel : Ndiogou Fall
N’Diogou Fall, président du Réseau des organisations paysannes et des producteurs de l’Afrique de l’Ouest (Roppa), nous livre sa vision des politiques agricoles.
Version longue : Entretien avec N’Diogou Fall (version longue)
Première partie – Regards sur les politiques agricoles
Les politiques agricoles en Afrique subsaharienne : une symphonie inachevée
Les politiques agricoles ont connu d’importantes évolutions au cours du temps. Mais des politiques interventionnistes nationales aux politiques d’intégration régionale en passant par l’ajustement structurel, les évolutions n’ont pas mené au développement tant attendu d’un secteur pourtant vital.
Politiques agricoles : de quoi parle-t-on ?
Le terme « politique agricole » fait partie de ces mots aux usages multiples qui sont repris sous des sens différents. Divers interlocuteurs employant le même mot font en fait référence à des concepts distincts. Pour éviter la confusion, il est donc nécessaire de préciser ce que l’on entend par « politique agricole ».
Agriculture : quelle vision pour quelle politique ?
Doit-on soutenir les exploitations familiales ou développer les entreprises agricoles ? Une politique agricole est le reflet d’une vision, qui résulte de choix politiques. Mais souvent, les décideurs ont du mal à trancher… il en ressort des politiques de compromis pas faciles à mettre en œuvre.
« On ne doit pas abandonner l’agriculture familiale mais accompagner sa modernisation »
Ousséni Salifou occupe le poste de commissaire en charge de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en eau à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) depuis 2007. Ce haut responsable politique régional évoque d’un ton libre les enjeux politiques d’un secteur sensible et en pleine évolution.
Version intégrale : Entretien avec Ousséni Salifou, Commissaire à l’Agriculture de la CEDEAO
Deuxième partie – Derrière les politiques, des questions concrètes…
Foncier
La sécurisation foncière : un des défis majeurs pour le nouveau siècle
L’enjeu foncier en Afrique de l’Ouest rurale est plus que jamais d’importance, alors que la pression sur les terres augmente. Différentes solutions sont proposées selon les pays. Des processus nationaux de dialogue sur les politiques associant tous les acteurs concernés semblent indispensables.
La politique foncière au Burkina Faso : une élaboration participative ?
Les avis divergent sur le caractère participatif de l’élaboration de la Politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural au Burkina Faso. Les spécialistes admettent son caractère innovant, par le souci de ses concepteurs d’y associer tous les acteurs du foncier. Mais est-elle vraiment « participative » ?
Accès à la terre en Équateur : chronique d’un non-débat
Petit pays d’Amérique latine, l’Équateur a connu deux réformes agraires. Pour autant, les organisations paysannes revendiquent encore une révolution agraire. En effet, la loi en vigueur, qui garantit les droits des grands propriétaires, fait peu de cas des petits et moyens producteurs et des territoires indiens.
Formation
La formation agricole, parent pauvre du développement. Un enjeu politique
À l’heure où la situation alimentaire mondiale est alarmante, et où les politiques agricoles des pays en développement (PED) sont sous les projecteurs, il serait facile, face à l’urgence, d’oublier « l’urgence de long terme » : refonder les socles du développement agricole, notamment le capital humain, particulièrement en Afrique subsaharienne.
Version longue : La formation agricole, parent pauvre du développement. Un enjeu politique
Formation agricole et rurale au Sénégal : de la stratégie à la mise en oeuvre
Changer les pratiques et les comportements des acteurs, tel est l’un des défis majeurs de la formation agricole et rurale en Afrique subsaharienne. Au Sénégal, pays pionnier dans la mise en oeuvre d’une stratégie nationale dans ce domaine, des avancées notables sont constatées. Mais le vrai changement demandera du temps.
La Tunisie rénove son dispositif de formation agricole
La Tunisie s’est engagée dans un projet ambitieux de mise à niveau de son dispositif de formation professionnelle et de l’emploi (programme Manform). Cette réforme, engagée y compris dans le secteur de l’agriculture et de la pêche, vise à répondre aux besoins croissants en qualification d’un secteur en évolution.
Version longue : Quelques éléments de réflexion sur la rénovation d’un dispositif de formation professionnelle et technique agricole : exemple de la Tunisie
Conseil agricole
50 ans d’histoire du conseil agricole en Afrique de l’Ouest et Centrale
L’étude du conseil agricole en Afrique sur ces 50 dernières années constitue une sorte de fil rouge dans l’analyse des politiques agricoles. Plus largement, elle questionne la place des agriculteurs et de leurs organisations dans la construction des stratégies et politiques agricoles.
Version longue : 50 ans d’histoire du conseil agricole en Afrique de l’ouest et centrale (version longue)
Le conseil agricole au Cameroun : une pièce maîtresse du développement rural
Au Cameroun, une table ronde a rassemblé une quarantaine d’acteurs autour de la question « Place et rôle du conseil agricole dans les politiques agricoles ». L’occasion de débats animés et ouverts, où ont été abordés de multiples sujets comme, entre autres, celui de la définition, du rôle, du financement du conseil.
Paysan à paysan : le conseil agricole au Nicaragua
À la base programme destiné à améliorer la conservation des sols, le programme « Paysan à paysan » de l’Union nationale des agriculteurs et éleveurs du Nicaragua est devenu une référence en matière de développement rural en Amérique latine, faisant des paysans des acteurs politiquement engagés et écoutés.
Financement
Évolution du rôle de l’État dans l’accès aux services financiers des populations exclues
De l’intervention à l’ajustement structurel, les États des pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ont opté pour des stratégies opposées dans la deuxième moitié du XXe siècle. L’échec de ces mouvements successifs appelle de nouvelles politiques, et peut-être avant tout, de nouveaux partenariats.
Financement de l’agriculture à Madagascar, le point de vue d’une OP
À Madagascar, de récentes expériences, prometteuses, de bonification des taux d’intérêt des crédits accordés par les IMF ont été abandonnées. Mamy Rajohanesa, président de Fifata, en appelle à un appui de l’État sur la durée qui permette aux producteurs d’atteindre les objectifs ambitieux qu’il a fixés.
Pour des politiques et une régulation adaptées au financement agricole et rural
Pourquoi des politiques spécifiques sont-elles nécessaires pour les finances rurales agricoles ? La question se pose en Amérique latine comme partout ailleurs dans les pays en développement. L’auteur tente d’y répondre, et, plus avant, essaie de dire « comment », à la lumière de l’expérience bolivienne.
Régulation des marchés
Pour la régulation et la stabilisation des marchés agricoles
Jean-Marc Boussard et Hélène Delorme, co-auteurs d’un ouvrage sur la stabilisation des marchés agricoles, apportent un éclairage sur la question en Afrique de l’Ouest. À la lumière des évolutions de l’histoire, ils offrent ici un vibrant plaidoyer pour la régulation des marchés agricoles.
Régulation des marchés agricoles au Sénégal : entre arbitrage et gestion concertée
Au Sénégal, l’émergence d’interprofessions est encouragée par la législation. Elle prévoit de leur confier plus de prérogatives dans la gestion des marchés. Si l’État conserve son rôle d’arbitre, la légitimité des politiques repose sur une « co-construction » de règles entre services publics et organisations privées.
Politique rizicole en Indonésie, entre protectionnisme et libéralisation
L’Indonésie compte 110 millions de ruraux dont la majorité produit du riz sur des exploitations microscopiques. Le riz est au coeur de son agriculture et de son alimentation. La politique rizicole a résisté longtemps à la libéralisation. La crise asiatique a sonné le glas de cette résistance.
Troisième partie – Enjeux transversaux
Comment financer les politiques agricoles ? Entretien avec Michel Petit
La question du financement des politiques est centrale. Sans financement, des politiques, quand bien même elles sont bien pensées, bien négociées, acceptées par tous, ne pourront être mises en oeuvre. Pour traiter cette question au combien complexe, nous avons eu un long entretien avec Michel Petit, ancien cadre à la Banque mondiale. En complément de cet entretien, nous vous proposons un encadré avec quelques repères sur le coût d’une politique agricole, et les marges de manoeuvres budgétaires des pays africains.
Des nouveaux acteurs et processus pour les politiques agricoles en Afrique ?
La participation des nouveaux acteurs est réelle dans l’élaboration des politiques. Pour autant, ces dernières demeurent difficiles à mettre en oeuvre. En complément, la directrice d’une organisation européenne d’agriculteurs apporte un témoignage édifiant.
Entretien avec Shelby Matthews, directrice du Copa-Cogeca
Le Copa- Cogeca, dont l’objectif est de représenter les intérêts des agriculteurs en Europe, regroupe des organisations agricoles et des coopératives agricoles. Au total 76 organisations nationales membres représentant les 26 pays de l’Union européenne.
Version longue : Entretien avec Shelby Matthews, directrice du Copa-Cogeca (version longue)
Compatibilité et articulations des politiques agricoles du national à l’international Cadre contraignant obligeant les pays à l’ouverture économique ou garde-fou limitant celle-ci, l’OMC définit, pour tous ses pays membres, des règles auxquelles ils doivent se plier. Les institutions régionales déterminent aussi leurs propres normes. Reste-t-il des marges de manœuvres pour des politiques nationales ?
Les politiques agricoles à l’épreuve de la hausse des prix
Quelques mois de hausse des prix ont remis les politiques de production agricole au centre du débat. Oubliant les leçons du passé, les discussions font la part belle aux enjeux techniques. Le défi est ailleurs : concevoir des politiques agricoles et alimentaires qui permettent aux producteurs de vivre et aux consommateurs de manger.
Panorama des politiques agricoles régionales européenne et d’Afrique de l’Ouest et du Centre
Matières premières
Café : petits producteurs, grands marchés
Les prix du café remontent, ramenant l’espoir de tirer un trait sur la crise qui a affecté la filière de 1997 à 2004. Mais il reste beaucoup à faire pour voir apparaître une caféiculture socialement et écologiquement durable.