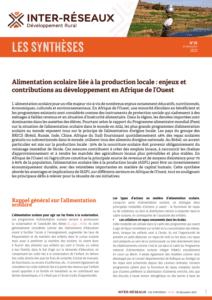Le G20 agricole a constitué une première dans l’histoire du G20. Cet événement corrélé aux inquiétudes sur les fluctuations haussières des cours internationaux de certains produits agricoles a suscité de nombreuses attentes, mais aussi des déceptions. Grain de Sel vous propose une confrontation des points de vue d’un réseau d’OP, d’une ONG et d’un représentant des Nations Unies sur les résultats de cette mobilisation internationale.
Le point de vue des OP ouestafricaines : Interview du président du Roppa

Grain de Sel : Quel bilan faites-vous du G20 agricole et de la déclaration finale ? Djibo Bagna : Ce qu’il faut saluer, c’est que le G20 inscrive à son agenda cette question de l’agriculture. Cependant on reste encore un peu sur notre faim. Nous sommes préoccupés par les retombées concrètes de ces grandes discussions au niveau de nos bases. Attention à ne pas reproduire les erreurs du passé : la définition des politiques publiques ne doit pas être monopolisée par des experts, il faut que les paysans aient leur mot à dire si nous voulons des changements véritables. Il faut associer l’expertise paysanne à l’expertise des techniciens et gouvernants. L’important c’est aussi que nous soyons impliqués non pas à la fin mais dès le début des réflexions. Aujourd’hui nous arrivons à une discussion déjà presque terminée.
GDS : Est-ce que les OP ont été associées aux négociations ?
DB : Le Roppa a été invité au G120 organisé par la FNSEA (NDLR : le « G120 » rassemblait des organisations de producteurs du monde entier) en préparation du G20 agricole. Mais les véritables négociations ont eu lieu dans des instances qui sont un peu des « grosses machines » des pays industrialisés dans lesquelles les pays ouest africains ne sont pas représentés.
GDS : Quelles étaient vos principales recommandations en amont de la rencontre ?
DB : Concernant la discussion sur les prix mondiaux nous plaidons pour une autre forme de gouvernance mondiale de l’agriculture, en dehors de l’OMC. Il nous faut sortir du système actuel où les gouvernements signent des accords commerciaux qui nuisent à leurs propres populations, à leurs marchés locaux et au développement du marché intra régional. Ces politiques vont d’ailleurs à l’encontre de celles qui ont été pratiquées par les pays industrialisés dans leur phase de développement.
GDS : Avez-vous constitué des alliances pour soutenir ces messages ?
DB : Nous avons été très clairs avec nos amis producteurs de l’ensemble des pays : on ne peut plus se permettre aujourd’hui de confier entièrement sa nourriture au soi-disant marché. Bien sûr que le marché est important pour l’agriculture. Mais la souveraineté alimentaire impose de bâtir des politiques adaptées à notre contexte. Les producteurs européens souffrent aussi de cette concurrence effrénée des États-Unis, du Brésil, etc. Nous autres, producteurs du monde, savons que nous avons intérêt à regarder dans la même direction parce que nous partageons les mêmes peines mais à des degrés différents. Le problème est au niveau politique. Et là, les grands mangent les petits…
GDS : Qu’attendez-vous des décisions des membres du G20?
DB : Nous n’avons pas eu de rencontres spécifiques avec les États mais nous sommes en relation régulière avec l’Union européenne, les coopérations internationales, les institutions internationales notamment dans le cadre de la mise en oeuvre de notre politique agricole commune à la Cedeao. A chaque fois que nous les rencontrons, notre message est clair : cette politique agricole régionale, nous l’avons élaborée dans un processus concerté, nous nous reconnaissons en elle, notre seul souci c’est de la mettre en oeuvre ! Nous verrons dans l’action quelles sont ses forces et ses faiblesses. Nous refusons qu’on vienne nous greffer d’autres choses en dehors de cette politique. Pour le moment notre objectif est celui là.
GDS : Est-ce que les questions de volatilité sont un enjeu de premier plan pour les producteurs ouest africains?
DB : Notre préoccupation c’est que la flambée des prix ne rende pas les aliments inaccessibles aux consommateurs et qu’elle puisse également bénéficier aux producteurs. En Europe les gens font la grève parce que les salaires qu’on leur donne ne leur permettent pas de bien vivre. C’est exactement la situation dans laquelle se retrouvent les producteurs de nos pays. Nous demandons des prix rémunérateurs, c’est-à-dire qui nous permettent de rembourser nos dettes, de payer nos charges et d’investir. Sur le plan international, ce qui vient interférer sur les prix, c’est le recours aux produits d’importation. Que ce soit le riz, les poulets congelés, les poissons, tous ces produits importés déstabilisent nos marchés parce qu’ils sont vendus à un prix en deçà des coûts de production. Ces phénomènes sont le résultat de politiques commerciales décidées en haut lieu, loin des producteurs.
GDS :Au niveau du Roppa, quelles sont les prochaines étapes concernant les questions de commerce international ?
DB : Les questions d’Accords de partenariat économique (APE) sont à notre agenda. Nous avons appris que les négociations ont repris sans que la visibilité soit très claire. Nous ne pouvons accepter que nos pays ou notre région puissent aller signer des accords qui remettent en cause ce que les États eux-mêmes ont accepté : à savoir notre politique agricole commune, qui défend l’intégration et l’agriculture familiale, bien entendue ouverte à la modernisation. Nous avons martelé notre priorité : c’est la construction des marchés locaux. Ce que nous consommons, nous l’avons dans la sous-région. Pourquoi aller courir vers un marché incertain ? Nous souhaitons que tout accord tienne compte de cette dimension locale et régionale.
Le point de vue des organisations internationales : interview d’un représentant des Nations Unies

Grain de Sel : Le G20 agricole s’est tenu fin juin. Quel bilan faites-vous du contenu de la déclaration ministérielle ?
David Nabarro : Je suis personnellement ravi de la façon dont les ministres de l’agriculture des pays du G20 se sont entendus le 23 juin dernier, sur une déclaration importante. C’est la première rencontre ministérielle agricole de l’histoire du G20. Ils ont ainsi considéré l’agriculture sous de multiples facettes, non seulement comme moyen de produire de la nourriture et autres marchandises, mais aussi comme un moteur de croissance économique, une façon de générer des revenus en milieu rural, un secteur ayant un impact sur l’environnement (générant des défis mais aussi produisant des services environnementaux) et un secteur clé pour assurer un développement social équilibré. Cette attention politique accrue accordée à l’agriculture a encouragé les Nations Unies à agir sur ce secteur avec plus d’énergie.
GDS : Ne constatez vous pas un manque d’engagement du G20 pour agir sur les causes de la volatilité plutôt que sur ses conséquences?
DN : L’impact négatif de la volatilité des prix alimentaires, notamment l’extrême volatilité des prix sur les marchés locaux, est de plus en plus reconnue. C’est une menace pour les producteurs et les consommateurs. Mais la question est complexe et il n’existe pas de solution unique et simple. Une double approche est nécessaire afin de répondre aux besoins immédiats des populations vulnérables et de s’attaquer aux causes profondes de la volatilité des prix en même temps. Le plan d’action des ministres de l’agriculture du G20 est une contribution pour les deux pistes : la solution dépendra notamment de sa mise en oeuvre effective aux niveaux local et national. Les ministres de l’agriculture ont pris des décisions sur des actions sur lesquelles ils peuvent s’entendre et qu’ils peuvent mettre en place de façon coordonnée. Ils n’ont pas prétendu agir sur les choses sur lesquelles leurs gouvernements ne sont pas d’accord, ou qui vont au-delà de leurs responsabilités. Ainsi ils se sont gardés de ne rien imposer aux pays non membres du G20.
GDS : La déclaration n’a pas pris de mesure sur la question des agro carburants, pourtant désignés comme partiellement responsables de la hausse des prix par les rapports d’experts. Qu’en pensez-vous ?
DN : Il y a des questions difficiles sur lesquelles il n’y a pas de consensus aujourd’hui, parmi les ministres de l’agriculture du G20 et au-delà du G20. Ce qui me semble important est que les échanges de points de vue aient lieu. J’espère qu’ils vont continuer au sein des espaces de discussion globaux (en particulier dans le CSA, mais aussi dans le COP17, Rio +20, l’AGNU, etc.). Au-delà des biocarburants, je crois fermement en la nécessité pour les gouvernements et les parties prenantes d’examiner les liens entre sécurité alimentaire, énergie, climat, environnement, foncier et eau.
GDS : Le système d’information sur les marchés agricoles (AMIS) prévu par le G20 vous semble-t-il réaliste ? Comment inciter les entreprises à effectivement divulguer des informations compte tenu de leurs intérêts en jeu ?
DN : Il a été largement reconnu par les ministres de l’agriculture du G20 que pour être efficace, le système AMIS a besoin de données détaillées et exactes sur la production et les stocks. Cela nécessitera des améliorations dans l’exactitude des données fournies par les gouvernements. Les ministres de l’agriculture ont reconnu qu’ils ne maîtrisent pas une partie des données. L’importance de travailler avec le secteur privé afin d’améliorer la précision des données sur les stocks a été soulignée comme étant un élément complexe de la question.
GDS : Dans un commentaire post G20 agricole, vous mentionnez les besoins de collaborations entre agriculture familiale et grands propriétaires terriens (type agrobusiness). Quelle vision avez-vous de la collaboration entre petite et grande agriculture ?
DN : Les ministres de l’Agriculture du G20 reconnaissent pleinement la contribution des petits agriculteurs à l’alimentation, mais aussi à l’environnement et au développement socio-économique, ainsi que les défis auxquels ils font face. Les ministres de l’Agriculture du G20 se sont positionnés, non pas comme devant faire un choix entre les petits producteurs et les responsables de grandes exploitations, mais en cherchant à combiner toutes les formes et les tailles d’exploitations.
Je ne vois pas les petits et grands exploitants comme deux catégories opposées d’agriculteurs. Dans tous les pays que j’ai visités, j’ai vu un melting pot de producteurs combinant les « sans-terre », les très petits, les petits, les moyens, les grands et les très grands. Je peux aussi témoigner d’entreprises souhaitant combiner leurs intérêts, leurs capacités d’investissement et leurs forces de commercialisation avec les intérêts et capacités de production des agriculteurs. Il y a une grande gamme de possibilités pour trouver des modes spécifiques de collaboration et de cohabitation. L’agriculture contractuelle semble être un exemple de ce qui est actuellement développé.
Le point de vue des ONG : interview d’un responsable d’Oxfam France

Grain de Sel :Que pensez-vous des mesures prises par le G20 pour limiter la volatilité des prix agricoles ?
Jean-Cyril Dagorn : Placer la crise mondiale des prix alimentaires en haut de l’agenda politique du G20 était une bonne initiative. Malheureusement, les espoirs de voir les leaders politiques s’emparer de la question de la crise alimentaire ont été déçus. C’est uniquement en s’attaquant de front aux problèmes qu’il sera possible de la résoudre, notamment par une réforme des politiques erronées en matière d’agrocarburants qui détournent les aliments au profit des moteurs, et en aidant les pays pauvres à constituer des stocks pour faire face aux extrêmes de la volatilité des prix alimentaires.
GDS : Qu’espériez-vous de ces rencontres ?
JCD : On espérait que les ministres s’attaquent aux réglementations erronées sur les agrocarburants à la suite des appels à passer à l’action de la FAO, la Banque mondiale, le FMI et d’autres organisations internationales. Pourtant, alors que les ministres se sont entendus pour analyser les liens existants entre la production d’agrocarburants et la volatilité des prix alimentaires, ils n’ont pas été capables d’adopter une quelconque mesure concrète visant à réformer les réglementations sur les agrocarburants ou ajuster les objectifs de production quand l’offre alimentaire est menacée. Les États-Unis, le Brésil, le Canada et la France figurent parmi les pays suspectés d’avoir bloqué toute avancée en la matière. En 2010, alors qu’une seconde crise alimentaire en 3 ans débutait, environ 40% du maïs américain a été destiné à la production d’éthanol plutôt qu’à l’alimentation du fait des lois du gouvernement américain sur les agrocarburants.
GDS : Que préconisez-vous qui n’ait été proposé par le G20 ?
JCD : Les ministres de l’Agriculture se sont mis d’accord pour augmenter les réserves alimentaires d’urgence qui permettent de nourrir les populations en cas de crise. Un premier petit pas positif, qui ne règle toutefois pas le problème. En effet, une telle approche se concentre sur l’impact et les conséquences de la volatilité des prix sans s’attaquer aux causes de cette dernière. Les ministres du G20 n’ont pas réussi à reconnaitre que les réserves stratégiques ou stocks de régulation ont également un rôle déterminant à jouer pour aider les pays pauvres à faire face à l’extrême volatilité des prix. Le stockage de 105 millions de tonnes supplémentaires de céréales aurait été suffisant pour éviter la crise des prix alimentaires en 2007-2008; le coût de cette opération aurait été de 1,5 milliard de dollars, soit 10 dollars pour chacune des 150 millions de personnes qui ont rejoint les rangs des affamés suite à la dernière flambée des prix alimentaires.
GDS : Les améliorations prévues en termes d’échanges d’information ne vont-elles pas dans ce sens ?
JCD : Les informations sur la production agricole et les stocks alimentaires des différents pays aideront à analyser la situation alimentaire mondiale et prendre des mesures pour éviter les crises. Malheureusement, les ministres ne sont pas allés jusqu’à exiger des grandes entreprises agroalimentaires — qui dominent le commerce de nombreuses denrées alimentaires — qu’elles dévoilent les informations sur les stocks qu’elles détiennent. On estime ainsi que les seuls Cargill, Bunge, ADM et Dreyfus contrôlent près de 90% du commerce mondial des céréales.
GDS : Concernant les mécanismes d’assurance prévus dans le plan d’action du G20, quelle est votre avis ?
JCD : Sans action pour réguler et augmenter la transparence sur les marchés à terme et des matières premières mondiaux, les mesures proposées bénéficieront probablement plus aux institutions financières qui fourniront les assurances qu’aux pays en situation d’insécurité alimentaire qui les achètent. De plus, les petits exploitants les plus pauvres n’auront pas accès à ces mécanismes. Pour Oxfam, le G20 devrait concentrer ses ressources sur d’autres outils pour gérer les risques, tels que les stocks de régulation.
GDS : Pensez-vous que le plan d’action puisse relancer l’agriculture dans les pays pauvres ?
JCD : Si les ministres de l’agriculture ont reconnu que davantage d’investissements étaient nécessaires dans le secteur de l’agriculture, ils se sont toutefois concentrés sur le soutien aux investissements privés plutôt que sur des mesures concrètes permettant de renforcer les petits producteurs des pays en développement, et ne se sont pas donné les moyens de mettre fin aux accaparements de terres. Les petits paysans offrent pourtant le potentiel le plus important d’augmentation des rendements agricoles mondiaux pour nourrir les populations souffrant de la faim. En soutenant les agricultrices les plus modestes, on pourrait augmenter les rendements agricoles des pays en développement de 2,5 à 4%.
Pour aller plus loin : Inter-réseaux a publié en août 2011 un bulletin de veille spécial sur les enjeux relatifs au G20 agricole : http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/article/bulletin-de-veille-no180-special