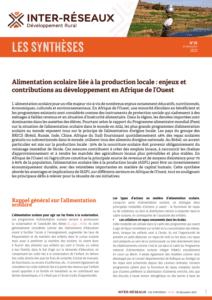Comment financer les politiques en faveur des plus démunis ? Les États disposent-ils de marges de manœuvre suffisantes ? L’aide internationale et le secteur privé offrent-ils des opportunités ? Plusieurs personnes de diverses institutions apportent quelques éclairages sur ces questions.
GDS : En 2003 à Maputo, les États africains se sont engagés à allouer au moins 10 % de leur budget à l’agriculture, afin de réduire de moitié l’extrême pauvreté et la faim d’ici 2015 ou 2020. Ces engagements ont-ils permis d’accroître les financements en faveur de la sécurité alimentaire ?
Alain Sy Traoré : Il y a eu des progrès en termes de quantité des investissements publics dans l’agriculture, mais on peut s’interroger sur leurs impacts sur la sécurité alimentaire. Les ressources comptabilisées dans la part des budgets alloués à l’agriculture ont-elles concrètement été investies dans les exploitations agricoles, en particulier familiales ? Ou ont-elles servi à acheter des véhicules, à financer des experts et à payer les salaires des fonctionnaires qui travaillent sur les questions agricoles et alimentaires ? Ensuite, la déclaration de Maputo dit bien « au moins » 10 %. On peut aller au-delà, même si tous les États n’ont même pas atteint cet objectif, 10 ans après Maputo.
Moussa Kaboré : Ces 10 % de Maputo ne doivent pas être une limite. Au Burkina Faso, nous avons mené une évaluation qui a montré qu’il faudrait doubler les dotations publiques actuellement allouées au secteur agricole (qui représentent aujourd’hui 14 % du budget total) pour atteindre un taux de croissance agricole de 6 %. Le problème, c’est que les ressources publiques sont sous contraintes. Il est donc important pour l’État de tirer au mieux parti de l’appui de ses partenaires et de l’implication du secteur privé. L’État ne peut pas tout faire seul.
GDS : Est-il possible de mobiliser davantage le secteur privé dans des politiques visant à lutter contre l’insécurité alimentaire des populations ?
AST : Il ne faut pas avoir peur de l’implication du secteur privé. Mais nous n’avons toujours pas trouvé les mécanismes permettant d’attirer les investissements privés dans l’agriculture vivrière et les exploitations familiales, pour qu’ils aient des impacts en termes de sécurité alimentaire.
GDS : La Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, lancée par le G8 en 2012, peut-elle permettre d’impliquer davantage le secteur privé dans l’agriculture afin de lutter contre la faim, notamment des plus pauvres ?
AST : Globalement, je ne crois pas en l’existence d’un secteur privé philanthrope : le secteur privé n’a pas attendu la Nouvelle Alliance pour investir là où il est possible de faire des profits. Il investit pour le moment très peu dans les cultures vivrières et je ne vois pas comment la Nouvelle Alliance va changer cela.
Éric Hazard : La Nouvelle Alliance n’a pas été élaborée pour appuyer les petits producteurs et lutter contre la faim. Son objectif explicite est de créer un environnement des affaires favorisant le business en Afrique. Il n’y aucun indicateur relatif à la sécurité alimentaire. Elle ne se pose pas la question de comment sécuriser et améliorer l’accès à la terre, aux intrants et au crédit des petits producteurs. La Nouvelle Alliance est une stratégie commerciale de l’USAID visant à vendre le savoir faire des grosses compagnies américaines. Avec un risque : en précipitant certaines réformes, sur des questions aussi sensibles que le foncier, elle risque de créer des incohérences et des frustrations.
Roger Blein : Il y a une certaine confusion sur cette question des financements privés : qui sont ces investisseurs ? Que recherchent-ils en plaçant leurs investissements dans l’agriculture ? Dans quel segment des chaines de valeur sont-ils intéressés à le faire ? Quelle est la relation entre ces choix et les différentes dimensions de la sécurité alimentaire ? Dans la production, au-delà des petits producteurs qui investissent dans leurs exploitations, les privés ne vont pas aller soutenir les exploitations familiales, cela n’a aucun sens. Pour ce qui est des exploitations agro-industrielles, on est plutôt face à un risque d’éviction des petits producteurs vulnérables. Il est également difficile d’imaginer que le privé va financer les aspects non agricoles de la sécurité alimentaire (notamment les services sociaux de base, la protection sociale). Les impacts positifs peuvent être envisagés au niveau de l’amélioration des circuits d’approvisionnement en intrants, et au niveau de l’aval de la production, dans la chaine de transformation-distribution.
GDS : Comment mobiliser des financements pour les aspects non agricoles de la sécurité alimentaire ?
Roger Blein : La question du financement de la sécurité alimentaire appelle à questionner l’ensemble du budget de l’État, pas juste celui du ministère de l’Agriculture. Ce qui pose une question complexe : comment faire pour que l’ensemble des ministères impliqués dans les questions de sécurité alimentaire y accordent une partie de leur budget ? Le cas du Brésil est intéressant. Lorsque le programme « Faim zéro » a été adopté, le pays était dans une situation budgétaire difficile. Les différents ministères ne pouvaient engager en début d’année qu’une partie de leur budget. Le solde était libéré, ou non, en fonction de l’évolution de l’année fiscale et de la situation budgétaire du pays. Le Président Lula a décidé de sanctuariser la part du budget que chaque ministère affectait à « Faim zéro ». C’était une réelle incitation à accroitre leur contribution à cet objectif interministériel. Ensuite, si on réfléchit plus précisément au financement de la protection sociale, l’Organisation internationale du travail a estimé qu’il coûterait entre 2 et 6 % du PIB dans la plupart des pays les moins avancés. Dans le cas du Niger, on se situerait entre 60 et 190 milliards de CFA (120 à 360 millions de dollars). Or, les seules exportations annuelles d’uranium et de pétrole ont cru de plus de 500 millions de dollars depuis 2006 ! Comme le montre l’appel d’Olivier de Schutter pour un « Fonds mondial pour la protection sociale » (cf. encadré), les obstacles ne sont pas que financiers, ils relèvent aussi de la volonté politique des États.
Un Fonds mondial pour la protection sociale
Olivier de Schutter (Rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l’alimentation) et Magdalena Sepúlveda Carmona (Rapporteuse spéciale des Nations unies sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme) ont proposé la mise en place d’un Fonds mondial pour la protection sociale, visant à lever les 3 obstacles majeurs au financement de programmes de protection sociale dans les pays pauvres : (i) un défaut de volonté politique ; (ii) des budgets publics insuffisants ; (iii) la crainte des États de ne pas pouvoir financer des programmes couvrant une large partie de la population en temps de crise. Ce Fonds mondial comporterait 2 volets : le « fonds » proprement dit, permettant aux pays pauvres qui souhaitent mettre sur pied un socle de protection sociale de recevoir un appui financier de la communauté internationale ; un volet de « réassurance », ouvrant aux pays pauvres la possibilité de s’assurer contre le risque de n’être plus en mesure de financer l’augmentation de la demande de protection sociale.
GDS : L’aide internationale peut-elle permettre de financer durablement des politiques de sécurité alimentaire dans la région ?
EH : Les limites de l’aide sont connues. Aujourd’hui, il me semble essentiel pour les États d’Afrique de l’Ouest de se départir de ce « marché du développement » : ces États ne peuvent accepter l’ensemble des opportunités de financement qui se présentent à eux, sans interroger leur alignement avec les priorités établies nationalement 1. Dans certains pays sahéliens, entre 70 et 80 % du budget des États alloué à l’agriculture provient de fonds des bailleurs. De fait, ces financements ne coïncident pas forcément avec les priorités des États. Ainsi, très peu de financements sont alloués à l’élevage, alors que tout le monde sait que c’est un secteur clé pour la réduction de la faim et de la pauvreté. Il importe donc pour les États de repenser la place de l’aide dans l’agenda politique nationale.
Frédéric Bontems : Ces dernières années, la communauté internationale a pris pleinement conscience de la complexité croissante des défis du développement ainsi que de leur interconnexion. Dans ce contexte, l’APD seule ne suffit pas. L’atteinte des objectifs du développement doit passer par la promotion d’une approche plus globale du développement et de son financement. La France joue notamment un rôle central dans la promotion des financements innovants pour le développement, qui sont à même de générer des volumes de ressources importants, stables et prévisibles. La taxe sur les transactions financières initiée en août 2012 en est le parfait exemple. Afin de créer les conditions endogènes d’un développement pérenne, la France soutient par ailleurs le renforcement de la capacité de mobilisation des ressources domestiques par les pays en développement.
GDS : Est-il possible de mobiliser d’autres sources de financements durables pour financer les différents aspects d’une politique de sécurité alimentaire ?
EH : Oui, il suffit d’être créatif et de ne pas s’arrêter à des enjeux politiques de court terme. Au niveau régional par exemple, augmenter un peu les prélèvements communautaires de la Cedeao permettrait de dégager quelques centaines de milliards de CFA par an.
RB : Il existe en effet des marges de manœuvre. Je n’arrive pas à penser que les États de la région ne puissent pas desserrer l’étau budgétaire, y compris en faisant un peu d’endettement. Par ailleurs, ces pays sont pour la plupart assis sur des ressources considérables. On est finalement au cœur du débat sur la réduction des inégalités et du financement de la solidarité au bénéfice des plus démunis. Et cette question se pose à différentes échelles. Au niveau des pays, elle touche aux politiques fiscales redistributives. Elle se pose notamment dans le débat sur les industries extractives. Comment les pays négocient-ils au mieux les revenus de ces ressources avec les multinationales et comment utilisent-ils ces revenus ? Au niveau régional, quelle forme de solidarité entre les pays côtiers, qui tirent mieux partie de la mondialisation, et les pays enclavés ? Enfin, la question de la solidarité se pose au niveau international, mise en avant en particulier par Olivier de Schutter, qui défend une vision de la sécurité alimentaire et de la protection sociale comme des biens publics mondiaux : tout le monde doit y contribuer, en fonction de ses revenus, de ses ressources et de ses capacités.