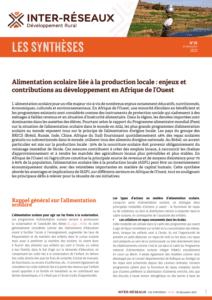Le concept de « résilience » a envahi ces dernières années le champ de la réflexion et de l’action dans le domaine de la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest. Quelles avancées concrètes apporte-t-il ? Quels défis soulève-t-il ? Différents acteurs impliqués dans les questions de sécurité alimentaire s’expriment à ce sujet.
GDS : Le concept de « résilience » évoque-t-il quelque chose de nouveau pour vous ?
Alain Sy Traoré (Cedeao) : Le terme de résilience est fortement mis en avant aujourd’hui, mais l’idée n’est pas nouvelle et ne doit pas être une panacée. Les notions de « capacité d’adaptation » et de « gestion durable des ressources » sont centrales en Afrique de l’Ouest depuis les années 70. Si l’on en parle tellement aujourd’hui, c’est parce que l’on constate que les actions humanitaires et les politiques de développement ont très souvent été cloisonnées, sans considérations mutuelles, avec des interventions courtes et limitées dans le temps. Elles n’ont de ce fait pas permis de sortir durablement les populations de la faim et de la dépendance des effets des aléas climatiques. Il est apparu nécessaire de mieux se concerter et de mieux fédérer les actions (principe de complémentarité de l’Ecowap) de l’ensemble des intervenants du champ de la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest dans le sens de la « résilience ».
Ibrahima Aliou (Apess) : La résilience n’est pas quelque chose de nouveau. Les éleveurs ont toujours trouvé des solutions pour résister aux chocs et s’adapter à leur environnement : la transhumance par exemple remonte à plusieurs siècles. La nouveauté, c’est qu’un aussi grand nombre d’acteurs s’intéressent à la « résilience ». Chaque période produit son propre concept. Aujourd’hui, c’est la résilience qui est à la mode.
GDS : Au-delà de l’effet de mode, est ce que ce concept de « résilience » apporte quelque chose de nouveau à la réflexion et à l’action dans le domaine de la sécurité alimentaire ?
Éric Hazard (Oxfam) : Il est évident que « résilience » est le nouveau mot à la mode. Celui qui veut travailler en Afrique de l’Ouest et/ou accéder à des financements est « obligé » de parler de résilience. En même temps, ce concept interroge le problème clé du cycle de crises alimentaires à répétition que connaît la région, en nous incitant à renouveler nos approches, nos pratiques et nos outils. Parler de résilience, c’est reconnaître que les approches humanitaires ne suffiront pas à résoudre les problèmes d’insécurité alimentaire. C’est admettre aussi que l’insécurité alimentaire n’est pas seulement une question de production agricole, mais aussi un problème d’accès à l’alimentation et de vulnérabilité. Si le concept de résilience permet aux États, à leurs partenaires, aux organisations de producteurs et aux ONG d’intégrer ces enjeux structurants et de modifier leurs approches, alors il apportera quelque chose de très important à la réflexion et à l’action dans le domaine de la sécurité alimentaire.
Christophe Tocco (USAID) : Pour l’USAID, la résilience représente une véritable innovation. Nous avons mis en place par exemple, au sein de notre organisation, des cellules réunissant les différents départements chargés de l’urgence et de l’humanitaire. Auparavant, ces deux mondes communiquaient peu.
Frauke de Weijer (ECDPM) : Je pense aussi que la résilience apporte une manière totalement différente de penser les choses. Dans la Corne de l’Afrique, l’introduction de programmes « pro-résilience » a ouvert des opportunités pour une réflexion et une action croisant les disciplines et les secteurs.
Moussa Tchangari (Alternative Espaces Citoyen Niger) : Pour moi, ce n’est qu’un effet de mode, après celui du « développement durable » ou de « la lutte contre la pauvreté ». On pense régler les problèmes en inventant de nouveaux concepts. Ce besoin d’inventer de nouveaux mots va de pair avec le manque de volonté politique de s’attaquer aux véritables problèmes. Et il témoigne encore une fois du fait que nous ne sommes pas maîtres des discours sur nous-mêmes ; nous ne faisons que les suivre.
GDS : Est-ce que les États de la région se sont réellement approprié ce concept de résilience ?
Pierpaolo Piras (Commission européenne) : il est clair que si la résilience peut améliorer l’efficacité de l’aide, elle ne peut pas occulter les problèmes d’intégration et de programmation. Le succès de cette approche reposera sur la capacité des États à s’approprier la démarche.
Mamoudou Hassane (i3N) : Je pense que l’on a tiré les leçons sur les limites de ces paradigmes qui se sont succédé ces dernières années. On a voulu à chaque fois imposer le même modèle à tout le continent, alors que les pays africains ne connaissent ni les mêmes réalités, ni les mêmes dynamiques. La résilience n’est pas une fin en soi, elle est un élément qu’il faut mettre dans son contexte. Elle n’est ni un programme, ni un projet, mais une vision, une approche. C’est une approche qui gagnerait à se construire, à partir des acquis et des réalités des différents pays. On n’ira pas loin si nos partenaires nous « vendent » la résilience et l’alliance Agir, qui en est la déclinaison, comme ils nous ont vendu les autres schémas de développement, en se substituant à l’existant et en se comportant en « donneur de leçons ». Par contre, on avancera si on arrive à rester dans un processus d’approche et non de programme, c’est-à-dire s’il revient à chaque pays de faire l’analyse de sa propre situation et de décider, à partir de ces éléments, ce qu’il faut faire et comment valoriser l’existant.
Madeleine Evrard Diakité (Oxfam) : En principe, le discours sur la résilience valide justement l’approche consistant à chercher à renforcer les capacités des acteurs régionaux, nationaux et locaux, qui ont le mandat et la légitimité d’agir sur les questions de vulnérabilité et de sécurité alimentaire. À bien des égards, l’Afrique de l’Ouest recèle de véritables potentialités pour avancer sur la question de sécurité alimentaire et de la gouvernance des réponses aux crises alimentaires.
GDS : La gouvernance actuelle de la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest permet-elle la mise en oeuvre effective de politiques « pro-résilience » ?
Éric Hazard (Oxfam) : A priori, on peut penser que non. Le discours sur la résilience part du constat qu’on ne peut plus se limiter à des approches strictement humanitaires pour répondre à des enjeux de long-terme et éliminer les causes structurelles de l’insécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest. Cela signifie que l’ensemble des organisations qui ont travaillé sur ces questions depuis des décennies vont devoir revisiter, dans une certaine mesure, leur mandat, les outils dont ils disposent, les mécanismes de coordination qu’ils ont mis en place, les efforts pour renforcer l’inter-sectorialité entre les différents ministères, commissions, etc. Je ne pense pas que l’on soit arrivé à ce stade là. Des négociations politiques sont en cours ; mais les acteurs traditionnels semblent plutôt avoir tenté de consolider leurs positions sans identifier les changements nécessaires à prendre en compte pour répondre efficacement aux enjeux induits par le concept de résilience. L’initiative Agir semble avoir inscrit dans le marbre une certaine architecture institutionnelle. On n’a pas suffisamment évalué les besoins institutionnels pour répondre à l’agenda résilience dans la sous-région, on a plutôt reproduit et renforcé la position des acteurs et des institutions existants. Il paraît difficile de penser, pour ne prendre que cet exemple parmi d’autres, que la Direction de l’Agriculture de la Cedeao ou les ministres de l’Agriculture des pays soient à même de porter seuls les politiques relatives aux piliers 1 (Protection sociale), 2 (Santé et nutrition) et 4 (gouvernance) d’Agir. Ces questions dépassent largement le domaine agricole. Le consensus sur la résilience ne suffit pas : il faut le traduire en termes de mandat et de responsabilités.
GDS : Identifiez-vous d’autres limites à ce concept de résilience, au regard des enjeux de sécurité alimentaire des populations vulnérables ?
Maty Ba Diao (Cilss) : Malheureusement, il n’existe pas encore de compréhension commune de la résilience. Pour certains, elle doit être ciblée sur les plus pauvres à travers des actions de développement, alors que d’autres insistent au contraire sur la nécessité de toucher l’ensemble des populations. Les différents acteurs ne sont pas encore d’accord sur le contenu et sur les indicateurs de mesure.
Madeleine Evrard Diakite (Oxfam) : Il ne faut pas que la résilience se contente de l’idée de « bounce back » (revenir au niveau de vie d’avant la crise), elle doit inclure la capacité des gens à améliorer leurs conditions de vie malgré les chocs, les « stress » et les incertitudes. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les capacités de résilience des populations sont directement liées à la question de la vulnérabilité et que celle-ci est déterminée par les rapports de pouvoir et les inégalités. Il y a un risque potentiellement lié à la notion de résilience qu’il est important d’éviter : c’est celui de dépolitiser la question du développement.
Jean-Luc François (AFD) : Il ne faudrait pas que l’attention portée à la résilience, c’est à dire au retour à la situation avant la crise, conduise à négliger la prévention du choc ou de la crise. Ainsi, en matière de prix agricoles, on risquerait d’évacuer la réflexion sur les politiques publiques et les instruments privés utiles au lissage d’une trop forte variabilité. Il y a dans le concept de résilience un fatalisme dont il faut se garder. En revanche, si renforcer la résilience d’une filière, d’un territoire, conduit à investir dans des mécanismes permettant de prévenir les chocs, alors c’est bien.