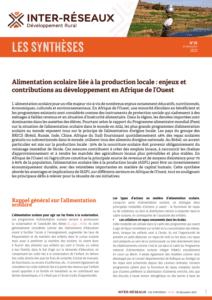Pression sur les ressources naturelles, explosion démographique, hausse de la demande en produits animaux, aggravation des conflits : le pastoralisme en Afrique de l’Ouest est confronté à de nombreux enjeux. À travers le regard croisé de différents acteurs, cet entretien interroge la viabilité du pastoralisme sur le long terme.
Grain de sel : Le pastoralisme sera-t-il en mesure de répondre à une hausse continue de la demande des produits issus de l’élevage ?
Christian Berger (Banque mondiale) : Pour moi, la réponse courte est clairement non ! Il y a une augmentation forte de la demande en produits animaux, liée à l’explosion démographique, l’urbanisation et la hausse du niveau de vie qui s’accompagne d’une évolution des régimes alimentaires. Le système pastoral doit continuer à exister mais il faudra en parallèle moderniser et intensifier les filières d’élevage sédentaires.
Abouba Saidou (gouvernement du Niger) : La demande est certes croissante mais la production aussi. Et puis jusqu’à preuve du contraire, le pastoralisme est la forme la plus rentable de production adaptée aux conditions climatiques des zones sahéliennes car les coûts de productions sont faibles.
Hélène Vidon (AFD) : Bien qu’elles soient peu fiables les statistiques montrent que les cheptels augmentent plus que ce que l’on pensait. Donc oui les systèmes agro-pastoraux ont une capacité de réponse à la demande sans doute plus importante que ce que l’on imagine mais ils sont quand même confrontés à une concurrence croissante des viandes blanches en milieu urbain ou des importations.
Seyni Amadou (Apess) : En tout cas, nous nous y croyons. Au Niger, malgré toutes les difficultés auxquelles les éleveurs sont confrontés, le cheptel s’accroit. Aujourd’hui il est estimé à plus de 41 millions de têtes et il approvisionne les pays côtiers.
GDS : L’avenir du pastoralisme ne dépendra-t-il pas de la capacité des agro-pasteurs à développer des liens étroits avec les acteurs en aval des filières ?
Pascal Rouamba (DDC) : Oui, l’élevage c’est aussi la capacité de maitrise du champ commercial !
AS (gouvernement du Niger) : Il est clair qu’il va falloir créer les conditions pour que ce mode de production traditionnel évolue vers un mode de production plus commercial qui va au-delà d’élever des animaux « pour le plaisir ».
CB (Banque mondiale) : Mais ils sont déjà en contact avec l’aval ! Aujourd’hui, les pasteurs et agropasteurs sahéliens produisent des animaux vivants vendus sur les marchés à des marchands de bétails qui sont eux-mêmes en contact avec leurs propres clients. Les liens avec l’aval sont forts et font vivre une multitude d’intermédiaires. Ceux qui pensent que c’est dommage de vendre des animaux vivants et qu’il faudrait commercialiser dans les pays côtiers des carcasses abattues et congelées au Sahel ne mesurent sans doute pas suffisamment le fait que la carcasse congelée est un produit normé pour lequel le Sahel fera face à des producteurs qu’il pourrait avoir du mal à concurrencer (Brésil, Irlande du Nord).
GDS : Le pastoralisme a-t-il un avenir dans un monde où le modèle de production capitaliste tend à s’imposer partout ?
AS (gouvernement du Niger) : On pourrait penser que c’est paradoxal de voir subsister un système de production traditionnel dans un monde capitaliste mais il y a des évolutions : les populations pastorales sont connectées au reste du monde, elles s’adaptent aux nouvelles règles de production et de commercialisation des animaux.
CB (Banque mondiale) : Regardez le pays ayant le plus intensifié les productions animales, les États- Unis : il y existe toujours une activité pastorale ! En France, en Espagne, en Italie aussi…
HV (AFD) : J’aurais tendance à dire que ce n’est pas le capitalisme et la mondialisation qui changent les choses. Je pense que c’est de la capacité et de la volonté des États d’offrir aux pasteurs l’accès aux services de base, que vont dépendre l’avenir du pastoralisme et son attractivité auprès des jeunes.
SA (Apess) : Le mode de vie des populations pastorales est justement ce qui les rend compétitives. La mobilité des troupeaux permet à l’élevage d’apporter une contribution économique énorme à nos pays.
GDS : Pensez-vous que les NTIC sont une des solutions face à la crise du pastoralisme ?
PR (DDC) : Oui. D’abord, ces nouvelles technologies évitent aux transhumants des déplacements dangereux, longs et coûteux pour accéder à certains services, notamment financiers. L’éleveur n’est plus obligé de transporter physiquement son argent. Ensuite, les nouvelles technologies permettent aux éleveurs de mieux connaître l’état des ressources ou des marchés, ce qui les aide à organiser leurs déplacements.
CB (Banque mondiale) : Oui, les technologies peuvent améliorer l’inclusion des pasteurs dans un système global. Mais on peut aussi imaginer utiliser des drones pour vérifier l’état d’un couloir de transhumance, l’avancée des cultures ou encore la densité de cheptels autour d’un point d’eau. Cela peut permettre de mieux prévenir les conflits.
GDS : Le pastoralisme a-t-il sa place dans un contexte marqué par l’augmentation rapide de la population et des cheptels ?
AS (gouvernement du Niger) : C’est en effet le plus grand défi pour les années à venir ! Les besoins en terres sont de plus en plus importants aussi bien pour les agriculteurs que pour les pasteurs. Les terres pastorales diminuent chaque jour mais on ne sait pas bien comment endiguer ce phénomène.
HV (AFD) : C’est une question à laquelle personne n’a encore de réponse. Un certain nombre de projets récemment lancés travaillent sur ces questions foncières et les conflits qu’elles génèrent. On espère qu’ils permettront d’avancer.
PR (DDC) : Ces tensions autour de l’accès à la terre sont en effet à la base de tous les conflits liés au pastoralisme. Je pense qu’on a besoin de renforcer la législation permettant de sécuriser l’accès aux espaces pastoraux.
GDS : Face à la multiplication des conflits violents, la solution pour les États n’est-elle pas de promouvoir des systèmes sédentaires au lieu de systèmes d’élevage mobiles ?
PR (DDC) : Je ne pense pas que ce soit dans le rôle ou même les capacités des États et de leurs partenaires d’imposer tel ou tel modèle. Pour ce qui est des ranchs par exemple, les États n’ont ni les outils ni les moyens d’accompagner techniquement, juridiquement et économiquement leur développement.
HV (AFD) : C’est une question politique extrêmement sensible qui relève des choix des États. Ce n’est pas vraiment à un bailleur de fond d’y répondre mais il n’existe pas forcément beaucoup d’alternatives viables à la mobilité des troupeaux en particulier dans de nombreux espaces sahéliens.
SA (Apess) : Obliger les éleveurs à se sédentariser, c’est complètement irréaliste !
AS (gouvernement du Niger) : La sédentarisation est inimaginable au Niger. Si nous pratiquons la transhumance c’est parce que les conditions agro-climatiques ne permettent pas de produire sur place. Les éleveurs sont obligés de se déplacer avec leurs troupeaux.
CB (Banque mondiale) : Je pense que la région aura besoin des deux systèmes d’élevage et qu’il y a de la place pour les deux. Dans la vaste zone fourragère du Nord du Sahel, il n’y a pas de système plus performant que le pastoralisme ; le modèle extensif mobile y est tout à fait adapté. Parallèlement, il faut travailler avec les pays pour développer un élevage sédentaire plus intensif, notamment pour les ruminants, mais aussi la volaille et l’aquaculture. On le voit déjà se développer au Sahel, en zone péri-urbaine.
GDS : Malgré la multiplication des études qui prouvent que le pastoralisme est un mode de production pertinent, la plupart des décideurs semblent vouloir sédentariser l’élevage. Pourquoi ?
CB (Banque mondiale) : Il est vrai que de nombreuses déclarations et décisions en faveur de l’élevage mobile sont peu appliquées. C’est sans doute en partie lié à une mauvaise connaissance du pastoralisme, mais aussi au développement de conflits armés impliquant parfois des éleveurs qui ont troqué leur bâton de berger pour une kalachnikov. Certains décideurs pensent que sédentariser l’élevage permettra de tout régler : améliorer la valeur ajoutée car les animaux seront finis sur place, accroître l’accès à l’éducation et à la santé des populations cessant d’être mobiles et régler les questions d’insécurité. Beaucoup de décideurs s’appuient sur des visions parfois caricaturales et souvent mal informées, dans les pays sahéliens comme dans les pays côtiers. Il faudrait plutôt tisser les fils d’un dialogue plus réaliste et tourné vers l’intérêt de la sous-région avec trois mots clés en tête : intégration économique, complémentarités et pacification sociale.
SA (Apess) : Les politiques de élevage sont décidées dans des grandes enceintes, comme les organisations internationales, dans lesquelles les éleveurs ne sont pas représentés. Ces institutions ont leur logique et leur vision de l’élevage. Les éleveurs ne peuvent qu’accepter et subir les conséquences de ces politiques. A l’échelle nationale, il est très difficile de changer les mentalités des élus. Même si vous y parvenez, cet élu fait partie d’une majorité politique dont le mot d’ordre est clair : « il faut rester dans la ligne, au risque d’être exclu. » Il y a parfois aussi des connivences fortes entre certains élus et fonctionnaires et des groupes d’acteurs qui n’ont aucun intérêt à soutenir le pastoralisme (des promoteurs qui investissent en zone pastorale par exemple).
HV (AFD) : Il me semble que cela découle, entre autres, d’une certaine volonté de simplification et d’une certaine vision de ce qu’est la « modernisation » de l’élevage. Il est plus difficile d’encadrer et d’administrer des populations qui se déplacent.
PR (DDC) : Il ne faut pas oublier qu’en face il y a des réalités sociopolitiques fortes. Pour beaucoup d’agriculteurs ou d’agro-éleveurs sédentaires, sécuriser la transhumance veut dire : « Les pasteurs vont envahir nos terres, et légalement en plus ! ». C’est difficile pour un décideur de tenir ce discours face à ses électeurs, et dans des situations parfois déjà explosives.
AS (gouvernement du Niger) : Le discours favorable à la sédentarisation est en partie dû à l’ignorance, en partie lié aux rapports de force au sein de nos États. Au Niger, les agriculteurs sont plus influents que les éleveurs et leur intérêt est d’accroître leurs champs, en occupant notamment ces espaces réservés à l’élevage.

GDS : L’évolution des fonctions vers un statut d’agro-éleveur est-il le gage d’une future concurrence ou complémentarité entre ces catégories ?
SA (Apess) : Cette évolution entraine une pression foncière croissante mais je crois que l’agriculture sans l’élevage c’est une agriculture à moitié. Un éleveur sans agriculture l’est aussi à moitié. Tout l’enjeu est de bien maîtriser cette situation, de mieux gérer l’espace.
HV (AFD) : J’imagine que cela va dépendre des cas, selon les accords locaux mis en place. Autrefois il y avait des accords entre agriculteurs et éleveurs pour des échanges de services, mais ils ont été rendu caducs par la complexification des statuts et des situations des producteurs (agriculteurs, éleveurs, agro-éleveurs….). Il y a d’autres partenariats à réinventer.
GDS : Face à la souffrance animale ou aux émissions de gaz à effet de serre importantes dues à l’élevage, certaines voix s’élèvent en faveur du végétarianisme. Qu’en pensez-vous ?
HV (AFD) : C’est un souci du Nord plus que du Sud. Une ferme de mille vaches en Europe n’a pas grand-chose à voir avec les systèmes d’élevage extensifs du Niger ou du Tchad. Il ne faut pas mélanger des situations qui n’ont rien à voir, entre un système d’élevage très industriel qui produit beaucoup d’effluents et un élevage extensif dans des zones où il n’y a pas beaucoup d’autres alternatives.
AS (gouvernement du Niger) : J’en ai entendu parler mais pour moi c’est une illusion, je n’y crois pas.
GDS : Face aux accusations de dégradation de l’environnement, le modèle pastoral est-il menacé sur le long terme ?
PR (DDC) : Non je ne pense pas, si on part sur cette base alors vous fermerez d’abord les entreprises !
HV (AFD) : Le risque environnemental est avant tout celui du surpâturage dans certaines zones. Le modèle pastoral sera menacé par lui-même s’il n’arrive pas à s’autoréguler face aux ressources disponibles.
AS (gouvernement du Niger) : Non, déjà cette hypothèse de dégradation par l’élevage pastoral je n’y adhère pas ! L’effet de serre est lié à autre chose qu’aux productions animales de systèmes extensifs.
SA (Apess) : Dire que le pastoralisme nuit à l’environnement est une erreur scientifique. Tant que les troupeaux existeront, le pastoralisme existera en Afrique de l’Ouest mais c’est sa forme pour les cinquante prochaines années qui sera en débat.
GDS : Quel est l’avenir de la réglementation régionale sur la transhumance, aujourd’hui remise en question par la décision de certains États de limiter la mobilité transfrontalière?
HV (AFD) : Différents programmes régionaux travaillent à une meilleure opérationnalisation de cette réglementation. L’enjeu sera notamment de remettre dans la boucle les pays côtiers. Cependant, jusqu’à présent, les actions se concentrent davantage sur les pays sahéliens, alors que les pays côtiers, qui accueillent les transhumants et sont un lieu important de commercialisation et de consommation de bétail, sont moins impliqués. L’enjeu sur les années qui viennent sera donc d’élargir le dialogue à l’ensemble des États concernés.
PR (DDC) : Les rencontres de haut niveau sur la transhumance transfrontalière apaisée, organisées depuis 2014 et qui rassemblant pays côtiers et sahéliens, permettent d’avancer dans l’opérationnalisation de cette réglementation régionale. Au niveau local, des cadres transfrontaliers sont également mis en place. On avance sur cette question.
SA (Apess) : Il est très important que les chefs d’État conservent une vision régionale du pastoralisme dans leurs discours et programmes. Mais le défi se joue aussi au niveau local : comment faire en sorte que les populations respectent les décisions prises régionalement ?
GDS : Il semble qu’il y ait une fracture croissante entre pays côtiers et pays sahéliens sur l’avenir des systèmes d’élevage en Afrique de l’Ouest. Dans quelle mesure cette fracture est-elle liée aux limites des politiques et des discours sur le pastoralisme ?
AS (gouvernement du Niger) : La fracture en elle-même résulte du besoin croissant en terres et la montée de l’identité ethnique des populations ; il n’y a que de très vagues politiques régionales sur le pastoralisme (comme la décision A/DEC.5/10/98), il y a par contre des discours et des déclarations (N’djaména, Nouatchok…).
CB (Banque mondiale) : Cette fracture me semble relever d’erreurs de jugement de part et d’autre ; peut-être est-elle pour partie liée à ce que l’accélération de l’information ne laisse plus aux décideurs le temps de l’approfondissement de la réflexion. En tout état de cause, les politiques et les discours doivent évoluer.
Seyni Amadou (seyni. amadou@yahoo.fr) est le Président de la cellule nationale de coordination de l’Apess au Niger.
Christian Berger (cberger@worldbank.org) est responsable du Programme d’appui au pastoralisme dans les pays du Sahel (PRAPS) à la Banque mondiale.
Pascal Rouamba (pascal. rouamba@eda.admin.ch) est Conseiller Régional, Développement Rural pour l’Afrique de l’Ouest à la Direction du développement et de la coopération (DDC) au Burkina Faso.
Abouba Saidou (calotropis2000@yahoo.fr) est Secrétaire général adjoint du ministère de l’Élevage au Niger et vétérinaire de formation.
Hélène Vidon (vidonh@ afd.fr) est chef de projet à la division Agriculture, Développement Rural et Biodiversité à l’Agence française de développement.