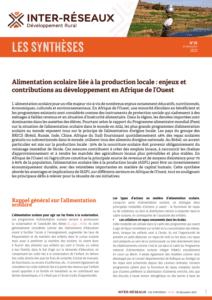Les pays sahéliens se sont dotés ces 15 dernières années de plans d’actions nationaux de lutte contre la désertification et d’adaptation aux changements climatiques, en vue de mettre en oeuvre des actions concrètes pour faire face à ces phénomènes. Qu’en est-il aujourd’hui de leur avancement et de leur efficacité ?
Les programmes d’action nationaux de lutte contre la désertification (Pan/LCD) et les Programmes nationaux d’adaptation aux changements climatiques (Pana) sont les instruments de mise en oeuvre au niveau national de deux des trois conventions majeures issues du Sommet de Rio, à savoir celle sur la lutte contre la désertification (Convention des Nations Unies de lutte contre la désertification — CNULD) et celle sur le changement climatique (Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques — CCNUCC). Si l’obligation d’élaborer des Pan/LCD pour les pays touchés par la désertification est inscrite dans le texte même de la CNULD, l’élaboration des Pana, décidée à la fin des années 90, vise à répondre aux préoccupations plus globales des pays les moins avancés (PMA) en matière d’adaptation aux effets des changements climatiques.
Les Pan/LCD et les Pana au Sahel : quels objectifs et quels contenus communs ? Les objectifs poursuivis par les Pan/LCD et les Pana se recoupent à plusieurs égards.
Les Pan/LCD sont considérés comme des « stratégies intégrées […] axées […] sur l’amélioration de la productivité des terres ainsi que sur la remise en état, la conservation et une gestion durable des ressources en terre et en eau, et aboutissant à l’amélioration des conditions de vie » des populations touchées. Ils identifient des axes prioritaires, des sous-programmes et une batterie d’actions à entreprendre en vue d’inverser la dégradation des terres et d’atténuer les effets de la sécheresse. Outre les actions par secteur (foresterie, technique de conservation des eaux et des sols, lutte anti-érosive, restauration du domaine sylvo-pastoral, promotion des énergies renouvelables, etc.), ils ont également identifié des mesures transversales à mettre en œuvre pour accompagner la gestion durable des terres (GDT) : renforcement des capacités des acteurs, communication et information des acteurs, suivi de la désertification, etc.
De leur côté, les Pana ont pour objectif de contribuer à atténuer les effets néfastes des changements climatiques sur les populations les plus vulnérables. Ils orientent les actions prioritaires à entreprendre par les pays, sur la base des secteurs d’activités jugés les plus vulnérables aux changements climatiques. Les actions identifiées couvrent des domaines tels que les ressources en eau (construction d’ouvrages hydro agricoles et promotion des techniques de captage et collecte des eaux, technique d’optimisation de l’utilisation de l’eau, promotion de l’irrigation de complément sur les cultures vivrières), l’agriculture et la foresterie (promotion de la restauration des sols et de l’agroforesterie à des fins agricoles, forestières et pastorales), les ressources animales (réduction de la vulnérabilité du secteur de l’élevage à travers l’amélioration de la production fourragère, la constitution de stocks fourragers, la sécurisation des zones à vocation pastorale et des espaces pastoraux stratégiques), et la santé.
Une analyse du contenu des Pana et des Pan/LCD montre que les actions prioritaires envisagées pour lutter contre la désertification et celles proposées pour l’adaptation aux changements climatiques se recouvrent à plus de 80%.
L’élaboration aussi bien des Pan/ LCD que des Pana s’est faite selon une approche consultative, itérative et inclusive en vue de s’assurer de la participation de tous les acteurs concernés. Ils sont le résultat d’une large concertation et d’un consensus au niveau national, régional et local dans l’identification des contraintes, des actions prioritaires et stratégies à développer en vue d’atténuer les effets de la dégradation des terres et des changements climatiques. Ainsi, en Mauritanie, le processus a été animé par les ONG et au Cap-Vert, par les municipalités. Quant au Sénégal, au Burkina Faso, au Niger et au Mali, les ONG et les plate formes paysannes étaient membres des comités de pilotage et des équipes qui ont fait la sensibilisation et l’identification des priorités.

Quelle cohérence des Pana et des Pan/LCD avec l’ensemble des documents stratégiques existants ? Les PMA sont engagés depuis trois décennies dans des processus de planification : les Plans d’actions sur les forêts dans les années 1980, puis les Programmes nationaux sur l’environnement (PNAE) au début des années 1990, les Pan/LCD à partir de 1996 (première et seconde génération), les Pana à partir de 2000, dans un contexte de Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté, de Stratégies de développement rural, etc.
On note un manque de cohérence entre ces différentes politiques : chaque processus se fait isolément et peine à s’intégrer dans une démarche et une vision globale de développement. Les programmes qui en résultent apparaissent plus comme des réponses à des engagements internationaux, des tentatives des pays pour paraître de « bons élèves » et mieux accéder à des ressources financières externes, plutôt que comme des réponses intégrées à des problèmes nationaux de développement. Cela explique leur faible niveau de mise en œuvre et les déceptions qui en découlent.
Si les États concernés avaient voulu que les Pan/LCD et les Pana soient de véritables réponses à des problèmes nationaux, et non des outils de mobilisation de ressources financières externes, les Pan/LCD auraient dû et pu constituer des cadres communs d’actions des différents acteurs autour de priorités, articulés sur des actions pertinentes de mitigation et d’adaptation aux changements climatiques.
Financement des plans nationaux : des résultats mitigés. L’interdépendance entre l’élaboration de ces plans nationaux et l’accès aux ressources financières extérieures est très forte. En effet, pour accéder aux financements disponibles, ou que la communauté internationale fait miroiter à travers les différents instruments de financement (OP15, Fonds carbone, Fonds d’adaptation, etc.), on impose aux pays de disposer d’un programme d’action. À la fin du processus d’élaboration, souvent long et laborieux, la désillusion est fréquemment grande : très peu de Pan/LCD ont en effet été mis en oeuvre à la hauteur des attentes des différents acteurs, faute de financements suffisants. On estime par exemple qu’au Burkina Faso, moins de la moitié des financements escomptés sur la période 2004-2006 ont été mobilisés.
À qui la faute ? Aussi bien les PMA que les partenaires au développement ont une responsabilité à endosser vis à- vis de ces résultats mitigés. D’une façon générale, le bilan de mise en oeuvre de la Convention sur la désertification est plutôt décevant et cela a motivé la Conférence des Parties à adopter, en 2007, une stratégie décennale. Aujourd’hui, les regards se tournent vers les Pana : beaucoup de pays sahéliens y placent un espoir pour le financement de la GDT. L’optimisme est-il permis ?
Les changements climatiques et la désertification : un défi de développement pour les pays sahéliens. Les pays sahéliens sont aujourd’hui confrontés à un triple défi : assurer la sécurité alimentaire d’une population en forte croissance, tout en gérant durablement leurs ressources naturelles et en faisant face aux changements climatiques.
Il y a heureusement des acquis importants au Sahel sur lesquels bâtir des politiques de développement agricole. Une étude de capitalisation des impacts des techniques et approches de lutte contre la désertification sur l’évolution de l’environnement et des systèmes de production au Sahel depuis le début des années 1980, a été initiée en 2005 par le Cilss. Elle a montré que, partout où des actions pertinentes de lutte contre la désertification ont été entreprises, il a été possible d’augmenter les rendements agricoles, d’améliorer la sécurité alimentaire et l’environnement, de réduire la pauvreté et l’exode rural, et d’amortir les chocs de la variabilité climatique.
Ces résultats montrent que, si les gouvernements sahéliens et leurs partenaires accordent une place de choix à la GDT, ils peuvent non seulement réduire la vulnérabilité des populations sahéliennes aux changements climatiques mais aussi améliorer la productivité agricole et réduire la pauvreté rurale. Pour les pays sahéliens, la désertification et les changements climatiques, qui sont étroitement liés, représentent un défi majeur pour le développement de la sous-région.
Le processus d’alignement des Pan/ LCD à la stratégie décennale 2008- 2018 de la CNULD, initié à la suite de la neuvième Conférence des Parties tenue en 2009, offre une nouvelle chance aux pays de la sous-région de redonner à la CNULD ses ambitions de départ, à savoir créer un cadre fédérateur pour une mise en œuvre efficiente des trois conventions de Rio, du niveau local au niveau régional. §