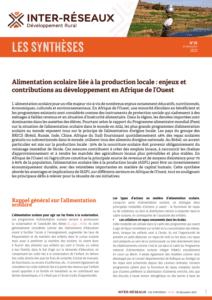Les politiques agricoles ambitionnent de faire de l’agriculture familiale l’un des piliers de la sécurité et de la souveraineté alimentaires de l’Afrique de l’Ouest. Or, l’économie alimentaire de la sous-région est en pleine transformation en raison de l’accélération de l’urbanisation, et de l’amélioration des revenus d’une part croissante de la population. «Les ménages s’approvisionnent de plus en plus sur les marchés, ils sont demandeurs d’une alimentation plus diversifiée, mais aussi plus facile à préparer et consommer. Mais comment ces bouleversements vont-ils être en mesure de profiter au développement des agricultures familiales ? Ces dernières seront-elles en capacité d’opérer les transformations internes nécessaires pour répondre aux nouvelles exigences du marché régional ?
Si cette perspective présente des opportunités pour la sous-région, elle n’est pas exempte de menaces, notamment dans un contexte où les ressources naturelles sont limitées. Le marché serait plus proche des producteurs, géographiquement mais aussi culturellement ; l’approvisionnement alimentaire serait moins dépendant des aléas internationaux et pourrait alors accompagner l’augmentation des revenus des agriculteurs et des éleveurs, au moins pour ceux qui sont en mesure de produire des excédents au-delà de leurs besoins familiaux. À l’inverse, l’essor de la grande distribution que l’on constate déjà dans de nombreuses villes pourrait, à terme, peser sur l’emploi des femmes et des jeunes dans les chaînes de valeur alimentaires et renforcer les habitudes de consommation de produits importés, et de suralimentation ; l’Afrique compte 52millions de personnes en surpoids ou obèses. L’intégration des chaînes de valeur par les acteurs agro-industriels pourrait, comme on l’a vu dans de nombreuses filières agro-industrielles, remonter progressivement jusqu’à la production et l’éviction des agriculteurs familiaux dans l’accès au marché. À terme, cela peut conduire à un déséquilibre dans la répartition de la valeur ajoutée des productions locales. Pour pallier à cet enjeu de création de valeur, commun à l’Europe et à l’Afrique, plusieurs initiatives ont été développées, dont certaines sont explorées dans ce numéro de Grain de sel.
Les dynamiques en cours et les acteurs qui émergent aujourd’hui incitent donc à définir de nouveaux modes de transformation, de distribution, et de consommation : entre structuration de l’aval en coopératives ; réglementations et autres normes sanitaires ; valorisation de la production par la certification et la labellisation ; approvisionnement des marchés institutionnels en production locale ; ou encore, nouvelles plateformes de distribution en ligne, etc. Dès lors, ces tendances permettent-elles le développement de filières en mesure, à la fois de répondre aux évolutions rapides de la demande, de faire face aux défis sociaux (pourvoir des emplois décents et durables, à l’ensemble de la population) et environnementaux, et de stimuler la production à destination du marché local ?
Pour faire des « systèmes alimentaires » un moteur de développement, il est impératif, pour quiconque s’intéresse aux enjeux des agricultures de la sous-région, de connaître, à l’aval des filières agricoles, les chaînes de valeur alimentaires et les acteurs qui les structurent. C’est ce qu’ambitionne le présent numéro de Grain de sel, dans le prolongement de livraisons plus anciennes (ainsi du Grain de sel n°58 sur la valorisation des produits locaux, publié en 2012; mais aussi du Grain de sel n°72 sur les jeunesses rurales ouest-africaines, publié en 2016 et qui interrogeait notamment les opportunités du secteur agroalimentaire en matière d’emplois). Ce numéro s’est principalement intéressé aux petites et moyennes entreprises agro-alimentaires. Il est donc l’occasion de revenir sur les différentes formes de structuration de l’aval des filières vivrières en Afrique de l’Ouest et d’interroger leur capacité à tirer les exploitations familiales.
Ce numéro est issu d’un travail collectif qui a mobilisé activement plusieurs membres d’Inter-réseaux ou partenaires proches pendant plusieurs mois. Nous tenons à remercier en particulier Roger Blein (Bureau Issala), Bio Goura Soulé (Hub rural), Christophe Boscher (AVSF), Estelle Dandoy (Acting for Life), Patrick Delmas (Reca Niger), François Doligez (Iram), Isabelle Duquesne (CFSI), Lia Gerbeau (AVI), Gifty Narh-Guiella (Corade), Kalil Kouyaté (Aguissa/Afrique verte Guinée), Stéven Le Faou (AFDI), Gilles Mersadier (AVI), Jean François Sempéré, et Marie-Pauline Voufo (Saild) pour leur implication aux côtés de l’équipe technique d’IR tout au long de la réalisation de ce numéro.