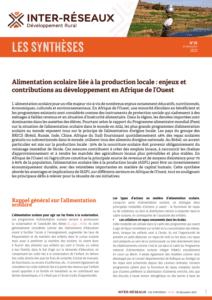Afin de répondre aux défis de la gestion des terres dans un contexte de ressources naturelles limitées, et avec l’objectif de lutter contre l’insécurité alimentaire, la dégradation de l’environnement et les conflits en zone rurale, le Niger a mis en place un outil original et novateur : le Code rural.
Un outil original et novateur de gouvernance du foncier. Dès l’indépendance du Niger, plusieurs dispositions législatives et réglementaires ont été prises pour sécuriser les droits des populations rurales agricoles. Parmi elles, la loi de mai 1961, qui fixe la limite Nord des cultures, définit la zone pastorale au nord de cette limite et interdit la pratique de l’agriculture pluviale audessus de l’isohyète 350 mm. C’est dans les années 1980 qu’une réflexion spécifique sur la question foncière s’est engagée. Plusieurs séminaires nationaux — auxquels ont participé les autorités politiques et administratives, les services techniques de l’État et leurs représentants locaux, les autorités coutumières et des représentants des différentes catégories d’exploitants ruraux — ont permis d’identifier un ensemble de défis relatifs à la gestion des terres et des ressources naturelles dans le pays : raréfaction et dégradation des superficies cultivables, diminution des espaces pastoraux (grignotés au Sud par l’agriculture, et au Nord par le désert), insécurité foncière et risques de conflits fonciers généralisés. Un Comité national du Code rural a été mis en place suite à ces séminaires et a proposé une ordonnance cadre, adoptée en mars 1993, portant les principes de base du Code rural et de la politique foncière rurale nigérienne. Les objectifs fondamentaux du Code rural y sont définis comme suit : « fixer le cadre juridique des activités agricoles, sylvicoles et pastorales dans la perspective de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de la promotion humaine » et « assurer la sécurité des opérateurs ruraux par la reconnaissance de leurs droits et favoriser le développement par une organisation rationnelle du monde rural ». Ce qu’on appelle le Code rural aujourd’hui est donc un ensemble de textes juridiques composé de l’ordonnance cadre de 1993 et d’une série de textes sectoriels relatifs à toutes les composantes du milieu rural (ressources naturelles, activités, territoires, sociétés, etc.). Le terme « Code rural » renvoie aussi à l’ensemble des institutions qui sont chargées de mettre en oeuvre les lois et les normes établies. Le dispositif juridique et institutionnel mis en place à travers le Code rural constitue un outil de régulation du foncier et des ressources naturelles extrêmement original en Afrique de l’Ouest, pour plusieurs raisons :
- il se présente comme le résultat de larges processus de concertation qui ont permis aux populations nigériennes d’exprimer, du niveau du village au niveau national, leurs préoccupations en matière de gestion du foncier et des ressources naturelles.
- le Code rural s’insère pleinement dans les stratégies politiques globales du pays. La politique foncière et agricole n’est pas cloisonnée, mais bien intégrée aux politiques économiques de développement qu’essaie de promouvoir le Niger.
- le Code rural possède une dimension sociale et culturelle essentielle. Il affirme que la terre doit être considérée comme un patrimoine commun à la nation et promeut une approche ouverte et participative incluant notamment les femmes, les jeunes et les minorités, tout en intégrant pleinement les chefferies traditionnelles.
Des avancées majeures vers une gestion plus équitable et plus durable du foncier. En dépit des crises politiques successives et de la profonde instabilité de l’État nigérien, la volonté de faire du Code rural un système participatif et inclusif n’a pas changé depuis les années 1980. Les chefferies traditionnelles qui, auparavant, étaient les seules à pouvoir attribuer des droits d’usage aux utilisateurs continuent à avoir un poids important, mais elles ne représentent aujourd’hui plus qu’une voix parmi d’autres. La gestion de la terre et des ressources naturelles est donc plus collégiale, et le Code rural, à ce titre, s’inscrit dans une avancée globale vers plus de justice, d’équité et de démocratie. En contribuant à la mise en place d’un espace de dialogue au niveau local à travers les commissions foncières, il renforce aussi sa vocation de promouvoir un État de droit dans les villages nigériens.
En outre, le travail de prévention et de régulation mené par les différentes commissions foncières a permis de réduire le nombre de conflits fonciers ainsi que leur intensité. Lorsque les conflits éclatent néanmoins, les commissions foncières servent d’outils de régulation et de médiation, et permettent de limiter le recours à la violence.
Enfin, au-delà de ces avancées sur le terrain, le Code rural se présente aujourd’hui comme un instrument de référence pour la mise en oeuvre des politiques nationales, et c’est sans doute l’un de ses principaux acquis. Il constitue à la fois un modèle d’inspiration et un outil puissant pour la mise en place des politiques de décentralisation depuis 2004. Au final, l’adhésion croissante des différents groupes d’acteurs aux principes du Code rural en fait un exemple réussi de politique concertée.
Des bases encore fragiles et des défis à relever pour l’avenir. Malgré ces avancées majeures, le Code rural reste aujourd’hui confronté à un certain nombre de défis fondamentaux.
Celui de la vulgarisation de ses principes d’abord. Le Code rural reste en effet largement méconnu dans les campagnes nigériennes, très peu alphabétisées. En 2010, seules 3000 commissions foncières de base étaient mises en places, sur un total de 15000 villages ou tribus, soit un taux de couverture de seulement 20%.
Le défi de la collégialité et de la représentativité des commissions foncières est également important. L’influence des chefferies traditionnelles reste encore prédominante. Les villageois continuent de s’adresser en priorité aux chefs religieux et coutumiers pour tout ce qui concerne la gestion du foncier et des ressources naturelles. Les acteurs institutionnels (secrétaires, élus, services techniques des mairies) ne sont ni bien insérés dans le tissu social, ni même clairement repérés par les populations locales, et bénéficient au final de bien peu de poids dans les décisions prises. Les représentants des jeunes et des femmes jouent le plus souvent un rôle purement figuratif et n’ont pas voix au chapitre.
Le défi de l’indépendance financière enfin, qui constitue un enjeu fondamental pour l’avenir. Les commissions foncières manquent de moyens matériels, de locaux et d’équipements, mais aussi du budget pour mettre en oeuvre des actions de sensibilisation ou des missions de terrain. Elles sont encore totalement dépendantes des projets de développement. Cette situation pose évidemment le problème de l’indépendance des commissions foncières mais aussi celui de leur pérennité.
Une expérience à diffuser et à mettre en débat pour mieux appréhender les défis qui se posent aux agricultures paysannes africaines. La question foncière se pose aujourd’hui avec d’autant plus d’acuité en Afrique que le contexte de limitation des ressources, de réchauffement climatique et de compétition exacerbée sur les terres renforce encore l’urgence de répondre aux défis de l’insécurité alimentaire. Pour les agricultures paysannes africaines, la sécurisation des droits fonciers et des droits d’accès aux ressources constitue un préalable fondamental à la mise en place de politiques agricoles et commerciales qui n’excluent pas les plus pauvres et qui ne renforcent pas des inégalités déjà intolérables. Elle constitue également un préalable majeur à la réalisation des objectifs de développement fixés par les États africains eux-mêmes et par la communauté internationale, ainsi qu’à la réalisation des droits économiques et sociaux des populations.
En dépit de toutes ses limites et de toutes ses imperfections, le Code rural du Niger constitue un processus particulièrement riche et novateur, qui prend en compte l’intégralité des utilisateurs du foncier agropastoral, et tente de construire des réponses collectives à des problématiques qui touchent l’ensemble des populations rurales, et en particulier les populations les plus marginalisées. Cet effort de participation et de concertation pose la construction d’un débat démocratique itératif, comme un outil indispensable à la construction d’alternatives équitables et durables dans le domaine de la gouvernance du foncier et des ressources naturelles. Le Code rural ne peut en aucun cas être considéré comme un modèle reproductible partout et dans n’importe quelles conditions. S’il est porteur d’espoir et d’avancées notables, c’est avant tout parce qu’il a été construit progressivement et qu’il continue à être amélioré et modifié par les populations nigériennes elles-mêmes. En revanche, les principes qui sous-tendent la construction et les fondements du Code rural du Niger peuvent très certainement constituer une source d’inspiration à l’élaboration de réponses adaptées à chaque contexte.
Le dispositif institutionnel du Code rural au Niger
Les commissions foncières sont les institutions qui mettent en oeuvre le Code rural et assurent le respect des normes établies dans ses textes. Elles s’établissent à toutes les échelles, du village au national. À chaque niveau, les commissions foncières ont des compétences et des prérogatives bien définies. Monsieur Abdul Karim Mamalo, secrétaire national permanent du Code rural entre 2000 et 2010, nous en explique le fonctionnement : « Les Cofob (commissions foncières de base) font essentiellement un travail de proximité : le contrôle des couloirs de passage, le contrôle d’accès aux points d’eau… et la délivrance des attestations foncières, notamment les donations, ventes, héritages, locations ou gages coutumiers de terrain. C‘est un travail qui ne peut être fait que par les commissions foncières de base. Les Cofocom (commissions foncières communales) interviennent dans l’identification des couloirs de passage, l’identification des points d’eau, l’identification des forêts, le système de matérialisation et l’inscription de ces ressources là au dossier rural. Donc toutes missions qui ne pourraient pas être faites par la Cofob. Les Cofodep (commissions foncières départementales) supervisent le travail des Cofocom, et assurent aussi la formation des membres des Cofob et des membres des Cofocom. C’est également les Cofodep qui délivrent les titres fonciers. […]. Au niveau de la région c’est un autre type de travail. La région supervise l’ensemble de l’édifice au niveau régional. La région intervient aussi dans le cadre du processus d’élaboration du schéma d’aménagement foncier. À chaque niveau, ce sont donc des missions différentes, et c’est la somme de toutes ces missions qui détermine le Code rural. »

„ Clara Jamart est politologue de formation, actrice du développement et de la solidarité internationale, spécialiste du développement rural et agricole. En 2010, elle a coréalisé pour Agter, en collaboration avec Loïc Colin et Vincent Petit (E-Sud Développement) et Inter-réseaux, un ensemble pédagogique multimédia sur le Code rural du Niger dont les résultats sont disponibles en ligne à cette adresse : http://www.agter.asso.fr/ rubrique129_ fr.html ou sur demande en version papier auprès de l’association Agter.