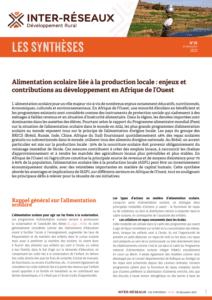Le réseau des OP d’Afrique de l’Ouest s’alarme des pressions foncières actuelles. Il rappelle que l’accaparement est un mal plus profond qu’on ne le pense. Il conteste l’idée selon laquelle les États ouest-africains n’auraient pas les ressources propres pour investir dans l’agriculture, et qu’il faudrait tout miser sur le privé pour développer le secteur agricole.

GDS : Quels sont les grands enjeux fonciers du moment en Afrique de l’Ouest selon le Roppa ?
Mamadou Goita : La situation est assez critique. Une grande majorité des pays membres sont sahéliens. Ceuxci sont confrontés au problème de la disponibilité des terres fertiles, aux difficultés d’accès à la terre, notamment pour les groupes les plus marginaux. De plus, si les gens ont accès à la terre, leurs droits ne sont en général pas sécurisés. On peut dire que nous sommes dans une situation de transition. Cette transition est relative aux politiques foncières qu’on voit émerger ici ou là et aux évolutions juridiques cherchant à mettre en place des balises pour sécuriser les utilisateurs du patrimoine foncier. Globalement la situation n’est déjà pas bonne, mais elle empire encore avec des phénomènes comme l’accaparement des terres, selon des modes d’appropriation qui diffèrent d’un pays à un autre.
GDS : Comment définissez vous l’accaparement des terres ?
MG : Les gens ont souvent une vision étriquée de ce concept. Certains limitent l’accaparement à des cas de cession (vente ou location à très long terme) de larges superficies (au-delà de 20 000 ha) par des acteurs étrangers, industries ou investisseurs. Pour le Roppa, l’accaparement est une notion beaucoup plus large. Cela renvoie à toute forme de transfert (cession, vente, location, emprunt) de terres à un opérateur national ou étranger qui a une influence sur la sécurité foncière des exploitations familiales, quelles que soient les superficies concernées. La taille n’est pas un critère fondamental : un accaparement de 5 ha en Guinée Bissau, en Gambie ou au Bénin, qui sont des pays où la disponibilité des terres agricoles est très réduite, et où les populations sont très denses, peut provoquer de grands dommages. Nous n’en faisons pas non plus une question de nationalité : nous parlons d’accaparement par des opérateurs nationaux aussi. Il y a aussi un débat sur les productions visées par l’accaparement. Au Roppa nous disons que ce n’est pas lié au type de production. Que ce soit pour produire de l’alimentation, (du mil, du riz…) ou bien du jatropha on peut parler d’accaparement. L’accaparement renvoie à cette idée que quelqu’un s’approprie un bien qui ne lui appartient pas.
GDS : Quels sont les arguments de ceux qui soutiennent que l’Afrique ne peut pas se passer des investisseurs, notamment étrangers, pour développer l’agriculture ?
MG : Il y a un certain nombre d’arguments qui sont évoqués pour justifier ce que certains appellent les « investissements » dans l’agriculture en Afrique. Le premier argument c’est qu’il y a des terres disponibles, délaissées par les producteurs qui n’auraient pas les moyens ou la volonté de les exploiter. On entend ainsi l’expression « terres marginales ». Un autre argument qui est avancé c’est que les dénommés « petits producteurs », qui ne sont autres que les exploitants familiaux, ont montré leurs limites pour nourrir la population croissante, donc il faut faire intervenir d’autres acteurs qui ont les moyens d’investir pour intensifier l’agriculture, l’élevage, la pêche. Un troisième argument donné est lié au changement climatique : les gens disent « nous venons investir pour produire des énergies renouvelables (agrocarburants) parce que le problème énergétique risque d’être un grand blocage pour l’économie en général et l’agriculture en particulier ». Quatrième argument : la libre circulation des capitaux est, dans la conception néolibérale actuelle, considérée comme une condition du développement. Elle ne peut pas épargner le secteur agricole qui est un secteur majeur pour beaucoup de pays africains. Il faut permettre aux investisseurs de mettre leurs capitaux dans le secteur (agricole) pour produire, approvisionner les marchés internationaux, et finalement créer les conditions pour l’alimentation de tous. Voilà des arguments entre autres qui sont évoqués. Mais fondamentalement ce qu’il y a derrière cet argumentaire, c’est que l’État est considéré comme incapable d’investir lui-même pour le développement de l’agriculture et qu’il doit donc faire appel à d’autres acteurs, des « nouveaux acteurs », les investisseurs privés.
GDS : Pensez-vous que les États aient les ressources pour investir davantage dans l’agriculture ? MG : Beaucoup de nos pays disposent de matières premières : de l’or pour le Mali, du pétrole pour la Côte d’Ivoire, le Nigéria, l’uranium pour le Niger… Il existe des ressources minières parfois très importantes qui sont sous-exploitées ou exploitées dans des conditions lamentables. La plupart de ces pays disposent des moyens nécessaires pour investir dans l’agriculture, mais ces moyens propres (internes) sont utilisés à d’autres fins, sans parler des problèmes de gouvernance et de corruption. Prenez un pays comme le Mali, troisième producteur d’or d’Afrique, après l’Afrique du Sud et le Ghana. Le Mali ne touche que 20% des revenus de l’or exploité par des multinationales. Nous avons fait des analyses pour démontrer que si on renégociait ce contrat minier pour le ramener seulement à 40%, il serait possible de dégager des capacités d’investissement qui dépassent les 100 milliards de FCFA par an, les mêmes causes produisant souvent les mêmes effets…
GDS : Que répondez-vous à l’argument des terres disponibles ?
MG : On est en train d’attirer des investisseurs sur des terres soi-disant marginalisées alors que des exploitants familiaux sont à la recherche d’espaces additionnels pour mieux produire. Par exemple à l’office du Niger au Mali, une étude sur plus de 3000 exploitations a démontré qu’environ 56% des exploitants familiaux disposent de moins de 3 ha. L’étude démontre également que le seuil de rentabilité pour un ménage de huit personnes est justement de 3 ha. Au dessous, vous ne pouvez pas produire suffisamment pour nourrir la famille, vendre un petit surplus pour payer les services sociaux de base (eau, éducation, santé etc.). Les exploitants familiaux ont besoin de terres supplémentaires. Ce n’est pas parce qu’on parle de « petits agriculteurs » qu’il faut les confiner dans des petites superficies qui ne permettent même pas de nourrir leur famille.
GDS : Que pensez-vous de la contractualisation ? Y a-t-il des cas où les investissements étrangers sont bénéfiques pour les exploitants familiaux ?
MG : Toute expérience a ses points positifs et ses points négatifs. Il y a des cas où les investisseurs peuvent impulser la création de richesses. Il y a des exploitants qui obtiennent des petits salaires et il existe des cas où des aménagements à petite échelle sont réalisés. Mais quoi qu’on dise, si on parle d’un investisseur privé, qu’il soit national ou international, il recherche le profit. Dès qu’il sent que ce n’est plus rentable, il cesse d’investir. Au Burkina des entreprises ont incité de nombreuses familles à investir sur des champs de jatropha. Aujourd’hui ces familles brûlent le jatropha pour faire autre chose. Selon les dires d’un producteur, avec le jatropha les producteurs gagnent aujourd’hui autour de 4000 à 8000 francs sur une récolte alors qu’ils pourraient gagner 175000 ou 200000 sur la même surface en faisant du maïs avec un bon accompagnement et en suivant l’itinéraire technique. On fait souvent miroiter des choses et in fine les paysans ne s’y retrouvent pas. Après tout, il existe peut-être des exemples bénéfiques pour tout le monde mais je n’en connais pas beaucoup à ce jour au Sahel.
GDS : Comment s’organise la lutte contre l’accaparement des terres ?
MG : Il y a beaucoup d’initiatives et à tous les niveaux : international, régional, national et même très localisé comme dans certaines communes ou villages. Au Mali il y a eu le forum paysan de Kolongo, c’était une initiative d’abord nationale pour dénoncer des pratiques très agressives dans la zone de l’Office du Niger notamment. Mais il y a eu aussi des initiatives au Bénin, où des villages entiers ont été cédés avec la complicité de chefs traditionnels à des investisseurs chinois qui ont cherché à faire déguerpir les gens. Dans la zone de Kolokani au Mali, des populations se sont mobilisées et ont pu récupérer leurs terres. Au niveau de l’office du Niger, l’affaire est allée assez loin, l’État a tenté de remettre en cause certains contrats qui avaient été signés par des personnes différentes, ministre de l’agriculture, ministre en charge des domaines de l’État, directeur de l’Office du Niger… Cette résistance existe aussi au niveau global. Il y a des initiatives avec la Via Campesina, le Roppa, FIAN et bien d’autres acteurs présents lors du Forum social mondial à Dakar. Nous participons également aux discussions sur les directives volontaires de la FAO et sur les principes des investissements responsables de la Banque mondiale que nous trouvons pernicieux. Le Roppa est aujourd’hui en train de faire un document de position sur l’accaparement des terres. Le Roppa a tenu à maintenir le concept d’accaparement des terres contre ceux qui voulaient parler de « cession massives de terres ». Notre position est très claire au niveau du réseau, on ne veut pas de spéculation autour du foncier. Il faut que des organisations telles que la nôtre se mobilisent au niveau régional pour que les paysans de chaque pays sachent qu’ils ne sont pas seuls. Nous nous entourons pour cela de juristes spécialisés pour nous aider dans nos interpellations des autorités régionales ou nationales.
GDS : Que pensez-vous du débat sur la titrisation ? Pensez-vous qu’il faille offrir un titre de propriété à tous les paysans ?
MG : Il y a d’autres modes de sécurisation foncière qui existent aujourd’hui. Il s’agit des modes collectifs de sécurisation qui permettent aux exploitants d’être sereins sur leur terre sans avoir un titre individuel de propriété. Le titre est la voie royale pour concentrer le patrimoine foncier dans les mains de quelques opérateurs, en particulier les banques qui le demandent comme garantie. En effet si la terre est mise en garantie pour obtenir un crédit, lorsque l’on voit les taux d’intérêt qui sont pratiqués, très supérieurs au taux de rentabilité des exploitations familiales, les producteurs courent à la faillite. Après quoi, le titre foncier * se retrouvera dans les mains des banquiers, qui vont les rétrocéder aux plus offrants. La plupart de nos pays sont dans une logique de la privatisation du patrimoine foncier. Mais en Afrique de l’Ouest et en particulier dans mon pays, le Mali, on dit que la terre appartient à trois personnes. Elle appartient d’abord aux morts, aux ancêtres, qui nous ont légué ces terres. La terre appartient également aux vivants, qui doivent pouvoir se nourrir et vivre de ce bien. Les troisièmes propriétaires sont ceux qui vont naître. La terre leur appartient. Il faut qu’ils puissent profiter demain de cette ressource. Si on oublie un de ces trois propriétaires, on en vient à la situation d’aujourd’hui : on achète, on épuise la terre et puis on s’en va.
Mamadou Goita est ingénieur et socioéconomiste du développement. Il est le secrétaire exécutif du Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest (Roppa). Le Roppa regroupe des organisations de 13 pays d’Afrique de l’Ouest. Il est également directeur exécutif de l’Irpad, Institut de recherche et de promotion des alternatives en développement, et président d’Amassa Afrique verte Mali.