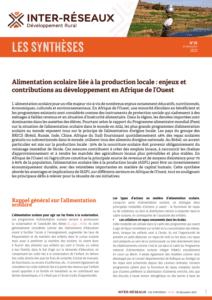L’appréciation de l’ampleur des transferts de terre se heurte à un accès difficile à l’information. Cette situation évolue favorablement avec la mise à disposition de portails de type Google Earth. On n’en est que plus étonné de lire des appréciations déconnectées des réalités les plus évidentes sur l’occupation réelle des terres.
La réponse des agronomes et des géomaticiens
Un tiers des terres arables mondiales seraient effectivement cultivées. Dans une étude commandée par l’International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) et la FAO parue en 2002, les auteurs estimaient que dans le monde, seul un tiers des terres arables sont effectivement cultivées, soit 1,5 milliard d’ha sur un total de 4,2. Il resterait ainsi 2,7 milliards d’ha de terres exploitables non cultivées, pour moitié situées dans les pays en développement. Plus récemment en 2010, Laurence Roudart a analysé les trois bases de données actuellement disponibles pour évaluer les terres disponibles, celle de l’IIASA (dite Gaez), celle de la FAO (Faostat) et celle du Center for Sustainability And the Global Environment (Sage). Ce sont des données d’origine statistique ou satellitaire. Selon trois hypothèses, plus ou moins restrictives, l’extension de la superficie cultivée mondiale pourrait être de 1 milliard d’ha au plus bas, 1,45 en hypothèse moyenne et 2,35 milliards d’ha dans l’hypothèse haute. Tenant compte de différents facteurs de correction et se situant dans l’hypothèse basse, celle qui ne touche pas aux forêts, par exemple, elle arrive à un total de 527 millions d’ha disponibles. Une autre étude, Agrimonde (2009), due à l’Inra et au Cirad, explique que d’ici 2050 il sera possible de gagner à la culture une superficie de 590 millions d’ha, dont 224 pour les agrocarburants, chiffre que Laurence Roudart estime « non seulement plausible mais même modeste ».
On comprend surtout qu’on puisse parvenir à de tels totaux, quelle que soit l’hypothèse, si on compte les forêts, si on n’ôte pas les zones protégées, les surfaces occupées par les villages et les villes, si on ne tient pas compte de sévères contraintes existant sur des zones pourtant classées comme étant disponibles et si on retient les pâturages comme zones possibles d’extension. Par exemple, dans les estimations les plus hautes, la répartition géographique des terres ainsi présumées disponibles fait immédiatement surgir le Brésil et la République démocratique du Congo, c’est-à-dire les deux pays possédant les deux plus grandes forêts du monde ! L’Afrique est au coeur de ces statistiques et de ces cartographies. C’est dans ce continent qu’on pointe les possibilités d’extension les plus fortes, installant ainsi le concept de continent-hôte. Comment récuser les investissements étrangers quand on nous dit que les deux tiers des surfaces arables sont inexploitées ? Comment oser contester quelques dizaines ou centaines de milliers d’ha, quand on nous dit qu’entre un et deux milliards d’ha sont disponibles ?
Un usage discutable des chiffres et des cartes. De tels chiffres sont les produits de méthodologies discutables, lorsque celles-ci ne regardent pas vraiment ce qu’elles sont censées observer. Leur caractère universel et généralisable est en cause. Dans certaines méthodologies on travaille avec des images qui ont un pixel de 5 minutes angulaires, c’est-à-dire qui couvrent une surface de 86 km², réduite ensuite sur les images qu’on nous montre sur moins d’un millimètre carré : 86 km² c’est le territoire de trois ou quatre grosses communautés, avec leurs villages et leurs hameaux. Bien entendu, on ne les voit plus ! Si l’on veut tirer des considérations sur l’occupation il n’y a pas d’autre voie que d’en passer par la cartographie détaillée et l’inventaire des formes. Le défaut de ces études est donc de ne pas corréler l’examen global avec de nombreux sondages à très haute définition pour voir le réel. Quand on le fait, on voit du plein là où les études cartographient du vide. La responsabilité n’est pas due à l’imagerie elle-même, mais bien à l’usage réducteur qu’on en fait. On ne sait plus associer l’analyse automatique à échelle très vaste avec l’observation à vue à échelle très détaillée et concrète.
Bien entendu, ma critique ne porte pas sur la légitimité de la pratique de la géomatique. Elle ne vise que les praticiens qui ne savent pas dire aux décideurs qui les consultent : nous ne pourrons répondre à votre demande qu’en associant les méthodologies.
Il existe donc un risque majeur : que des modes d’observation extensifs et des études trop globales, utilisant la prétendue ubiquité d’observation des images de satellites, conduisent à des appréciations fausses des réalités géographiques et sociales. Ensuite, sur le terrain, si on conduit un investisseur qui ne connaît rien aux systèmes fonciers dans certaines brousses, on peut réussir à lui montrer ce qu’on veut : il n’y voit aucun champ comparable à ceux qu’il connaît dans son pays d’origine et il peut en conclure que la place est effectivement libre. Plus généralement, on ne possède pas d’inventaires cartographiques sérieux et publics qui permettraient de savoir ce qui est occupé, ce qui est à l’abandon, ce qui est titré, ce qui ne l’est pas, ce qui est terre de parcours, ce qui fait l’objet d’une agriculture cyclique, etc. De telles cartes se réalisent à des échelles très détaillées, sinon elles courent le risque d’être elles-mêmes vides… de sens. C’est un des buts de l’Observatoire des formes du foncier dans le monde que développe France Internationale Expertise Foncière.


Sur l’image Landsat (en haut), l’échelle réduite et la tonalité uniforme donnent une désespérante impression de vide : on ne voit pas Sanamadougou (flèche). Mais dès qu’on zoome (en bas), on voit le village exactement partagé par les périmètres des concessions aux Moulins Modernes du Mali et à Sosumar. (Image Landsat et capture de Google Earth)
La réponse des théoriciens et des gouvernements
Des « terres oisives », selon les économistes. Les théoriciens de l’économie, comme par exemple ceux de l’école de Stanford (Paul Romer), quant à eux, développent des rhétoriques adaptées à l’idée de vacance des terres : les continents sans lumières, les terres oisives, l’abandon.
Rappelons un exemple historique : on se souvient de la façon dont la jachère a été instrumentalisée en Europe aux XVIII et XIX s. pour favoriser l’appropriation des terres collectives des communautés par des entrepreneurs et des agriculteurs riches. La jachère, c’était, dans les systèmes traditionnels, cette année de labours répétés pour préparer la terre, sans encore l’ensemencer, à un nouveau cycle de rotation. Jachérer la terre, signifiait la travailler et non pas la laisser reposer, et encore moins, pour l’agriculteur, se reposer. Or, à cette époque, on a réussi à inverser le sens puisque le terme signifie encore aujourd’hui le repos. Que s’était-il passé ? Pour mieux permettre l’appropriation de ces terres, les tenants de la nouvelle agriculture ont alors stigmatisé la jachère pour mieux la combattre et la dévaloriser.
C’est exactement ce qui se produit en ce moment, avec l’emploi de la notion de terres oisives ou de friches dans les continents réputés vides. Quand on parle d’« Idle » land, littéralement les terres paresseuses ou oisives, on ne fait rien d’autre que de stigmatiser un mode d’occupation des terres pour mieux en justifier l’appropriation. On conforte ainsi la dénonciation non innocente des terres dites « vacantes et sans maîtres ». On justifie même, dans certains cas, le fait de pouvoir les accaparer sans avoir à les reconnaître au préalable par des études d’impact sérieuses, puisqu’elles sont vides ou réputées telles. On répète donc, avec cette notion, et à l’échelle du monde, un processus de disqualification sociale et géographique que l’on a déjà connu dans le passé.
Paul Romer, par exemple, exploite une astuce dans ses présentations : il montre un planisphère nocturne qui a la fonction d’opposer les continents éclairés et les continents sans lumières. Il laisse ainsi se développer l’idée que des régions entières du globe sont vides et destinées à devenir hôtes des projets économiques des autres. Il peut alors résumer le monde à un triangle entre des continents-sources (par exemple l’Asie du sud et du sud-est, qui sont source de demandes de toutes sortes), des continents-hôtes (l’Afrique, l’Amérique latine, qui sont vides ou presque), et des continents-garants (l’Europe, les États-Unis, la Chine, qui ont les masses financières et les institutions).
Une situation juridique dont jouent les gouvernements. Après les experts de l’image, après les économistes, que disent les gouvernements des pays-hôtes ? Leur réponse va dans le même sens. Ils jouent sur la conception domaniale de la terre qui domine dans la plupart des pays en développement. Dans ces pays, il existe en effet une situation juridique qui fait que la terre n’est possédée en propre par personne, car tous les habitants ne sont que les usufruitiers du sol domanial. Dans ces conditions, les gouvernements prétendent que ce qui est domanial est géré par l’État, et ils usent de la terre à discrétion. En Afrique, on ne compte plus les « banques de la terre », les offices et les agences (« boards » ou « directorates »), suscités par les gouvernements, qui comptabilisent la terre et la placent auprès des investisseurs étrangers, quelquefois en leur garantissant qu’ils n’y trouveront personne.
Si on crée en Afrique des secteurs agro-industriels, il ne faut pas oublier qu’on le fera en transformant des situations existantes, écologiques ou agricoles, et non pas en passant de la terre vide et improductive à la terre fertile parce que mise en valeur. On le fera en déplaçant des populations car on touche à des zones peuplées. On se battra, notamment, pour le partage de la ressource en eau : par exemple, les investissements au Mali ne se font pas dans le désert, mais bien dans le delta intérieur du Niger, là où l’occupation est déjà très forte et la question de la quantité d’eau disponible deviendra vite problématique. L’investissement dans la terre ne concerne pas des zones vides mais bien celles sur lesquelles existent déjà une présence et des héritages. Là est le problème que les statistiques et les discours veulent masquer et que les gouvernements entendent exploiter.
Gérard Chouquer est agrégé d’histoire et directeur de recherches au CNRS. Rédacteur en chef de la revue Études rurales, il participe aux travaux de l’Ordre des Géomètres- Experts, à travers l’association France International Expertise Foncière. Il est membre du Comité technique « Foncier et Développement » de la Coopération française. Principale publication sur le sujet : Gérard Chouquer, Terres porteuses. Entre faim de terres et appétit d’espace, éd. Errance, à paraître en 2012