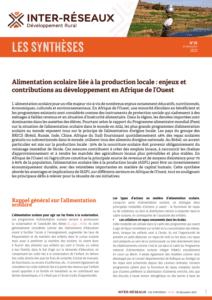Au Sénégal, des organisations non gouvernementales ont formé une alliance nationale : le Crafs, Cadre de réflexion et d’action sur le foncier au Sénégal. La coordinatrice d’Enda Pronat, membre du Crafs, nous explique sa vision et son combat pour « une agriculture saine et durable » au service d’un « développement équitable ».

Grain de sel : Pouvez-vous nous présenter rapidement les missions d’Enda Pronat ?
Mariam Sow : Enda Pronat (pour protection naturelle) est une entité de l’organisation Enda Tiers Monde. Au début des années 80, Enda avait réalisé une étude qui avait révélé que les pesticides représentent une menace pour les populations et l’environnement.
Après une étape forte de sensibilisation sur les dangers liés à l’utilisation des produits agro-chimiques à l’attention des producteurs et productrices, des scientifiques et des décideurs, nous sommes allés avec les acteurs de base sur des expérimentations pour trouver des alternatives à ces produits et aux techniques destructrices de l’environnement. En dehors de ces produits, il y a aussi les OGM qui menacent l’agriculture paysanne.
Dans nos zones d’intervention, des fédérations de producteurs se sont engagées dans la promotion d’une agriculture saine et durable pour une souveraineté alimentaire de nos pays en sécurisant les générations actuelles et futures. La réussite de ces alternatives doit être soutenue par une volonté politique des décideurs locaux et nationaux.
GDS : Le Sénégal est-il un pays qui connaît une augmentation des investissements directs étrangers dans l’agriculture ?
MS : Oui, quelque chose de nouveau menace toute l’idéologie dont nous sommes porteurs : il s’agit de l’accaparement des terres par les multinationales et les gros bonnets de nos pays. Aujourd’hui, la communauté internationale dit que l’Afrique peut nourrir le monde en ouvrant la porte à l’agrobusiness. Cet agrobusiness va détruire les ressources naturelles, faire disparaître les petits producteurs et les paysans deviendront des ouvriers mal payés sur leur propre terre. Au Sénégal, ce phénomène ne date pas de maintenant. Si je prends l’exemple des Niayes (bande littorale entre Dakar et Saint-Louis), cet accaparement a commencé depuis longtemps. C’est une zone de maraîchage et d’arboriculture qui a été dilapidée et ce sont de grandes personnalités qui se la sont appropriée. Alors on dit que ce sont les populations qui ont cédé leurs terres. Mais oui ! Mais ces populations pauvres, en l’absence d’information, de sensibilisation et d’accompagnement, ont-elles le choix ?
La loi sur le domaine national condamne celui qui achète, qui vend, qui loue, mais les élites ont trouvé des mécanismes pour soudoyer les conseils ruraux et aboutir à des délibérations déguisées. Dans la zone de Keur Moussa, des marabouts ont pris, avec la complicité des élus locaux, des terres de paysans qui se retrouvent sans rien. Avec la Goana (Grande offensive pour l’alimentation, la nourriture et l’abondance) et le plan biocarburants, les autorités ont demandé aux communautés rurales de céder des terres à ceux qui ont de l’argent et ce sont encore les gros bonnets qui se ruent sur les terres de leurs concitoyens.
Donc ici, ce sont les nationaux, les décideurs qui sont censés protéger les paysans, qui ont commencé ces appropriations malsaines. Et maintenant, ils font appel aux investisseurs étrangers pour exploiter de plus grandes superficies encore. Mais il y a toujours des nationaux qui sont associés d’une manière ou d’une autre aux étrangers.
GDS : Que répondez-vous à ceux qui considèrent que ces investissements constituent une chance unique de moderniser le secteur agricole ?
MS : Aux gens qui tiennent ce discours, je leur dis non ! Les terres sont là. C’est à l’État, avec les populations, de mobiliser notre savoir-faire, notre système de gouvernance traditionnelle et d’innover ; de réfléchir avec les gens pour définir une politique agricole très claire, trouver des modèles de finance-ment pour améliorer les systèmes d’exploitation familiale. Il faut arriver à un développement porté par les producteurs eux-mêmes, faire de l’agriculture un métier qui nourrit son homme et du milieu rural un milieu agréable à vivre. C’est la seule façon de parvenir à un développement équitable. Si tu vas aujourd’hui en milieu rural, il n’y a rien du tout là-bas. Ce que disent les politiques et la réalité, ça fait deux. On dit qu’il y a beaucoup de terres, mais si on regarde la population qui augmente, les autres activités rurales, que sont l’élevage, la cueillette, le bois de chauffe, on voit que les gens ont besoin de ces espaces non cultivés.
Il y a aussi toutes les promesses des investisseurs : construire des écoles, des dispensaires etc. Mais l’État a des possibilités pour assurer les services de base sans mettre en gage les terres des populations.
GDS : Comment travaillez-vous sur ces investissements, et notamment sur ses implications foncières ?
MS : Enda Pronat est engagé dans un combat pour dire non à ces investissements- là, où la transparence est nulle à tous les niveaux. Les investisseurs disent aux paysans que s’ils s’installent, il y aura des emplois. On a maintenu la population dans une pauvreté accrue. C’est certain que quand on te dit que tu vas travailler la journée à 4000 FCFA, tu dis oui, sans savoir combien de temps ça va durer, calculer si ça va te suffire pour manger, te soigner et assurer l’avenir de tes enfants.
Nous essayons au niveau local de sensibiliser ces personnes, d’interpeler les intellectuels ressortissants de ces terroirs, de leur fournir un maximum d’informations, de les aider à construire des plaidoyers. Nous les appuyons aussi dans la réappropriation de leurs terroirs. Quoi que disent les lois, les gens ne croient qu’à une seule loi : le terroir, c’est leur propre terroir. On ne pourra pas avancer si l’État ne le comprend pas. Nous devons également travailler davantage avec les jeunes. Il faut les aider à rester dans leur terroir et à avoir une éducation citoyenne et environnementale. Il faut aussi que les femmes soient plus présentes dans les instances de décision, pour défendre leurs propres intérêts et dire non quand il le faut.
Au niveau national, nous avons formé une alliance, le Crafs, avec d’autres organisations qui partagent nos préoccupations pour développer un plaidoyer en faveur des populations rurales. Nous nous organisons pour intervenir sur le terrain dès que l’on entend parler d’un cas d’accaparement. Je prends le cas de Fanaye. Dès qu’on a été saisi par les populations, le Crafs s’est immédiatement organisé pour collecter sur place des informations et discuter avec les deux partis : le président de la communauté rurale (le PCR) et les populations locales. Le PCR a touché beaucoup d’argent pour affecter ces 20 000 ha. Et les investisseurs payent à l’État les frais de bornage. Mais quel est l’intérêt des populations dans tout ça ? Quand elles ont décidé d’organiser une marche, on les a accompagnées. Puis nous avons diffusé au niveau national toutes les informations que nous avions collectées (j’ai donné par exemple des interviews dans des journaux) tout en restant en contact avec les populations concernées localement.
GDS : Ce sont les élus locaux, donc proches des populations, qui affectent les terres. Comment expliquez-vous que, dans certaines communautés rurales, ces élus affectent de vastes superficies à des personnes étrangères aux communautés ? MS : Ceux qui ont le plus de travail et sont les plus attachés à leurs terroirs ne cherchent pas à occuper ces postes. La plupart de ces élus ont besoin de sécuriser leur survie. Ils n’exercent donc pas ces fonctions dans l’intérêt général mais pour leur intérêt personnel et pour leur parti politique. C’est pourquoi en matière de sensibilisation il ne faut pas cibler seulement ces élus, mais toute la population. Je me souviens qu’en 1975, je travaillais pour les maisons familiales et nous dispensions des formations pour les élus et les sous-préfets. Quand nous avons dit que nous allions aussi former les villageois, les élus et les sous-préfets s’y sont opposés. Ils ne veulent pas que les villageois soient informés et formés. Et là nous avons un gros travail à faire. Il faut changer le système de gouvernance, il faut que les populations puissent suivre ce que font les élus, les interpeler et même remettre en cause leur mandat. Sinon, on s’oriente vers des révoltes populaires.
GDS : Comment voyez-vous la situation évoluer à moyen et long terme ? Etes-vous optimiste ?
MS : Si ça continue comme ça, avec ce système de gouvernance, ça va être très difficile. Mais je dois être optimiste quand je vois ce qui se passe dans d’autres pays, où les organisations paysannes ont réussi à engager l’État dans une réforme foncière et à y pendre part. C’est ce qu’il faut au Sénégal : qu’on aille vers une réforme foncière équitable, portée par les organisations paysannes, avec une société civile forte et des spécialistes déterminés pour les accompagner. Il faut aussi une implication réelle des intellectuels auprès des populations dans leurs terroirs d’origine. Avec ça, c’est certain qu’on peut changer le système.
Brefs repères sur le système sénégalais de gestion des terres rurales
Au Sénégal, les droits coutumiers * ont été abolis. Les terres des zones de terroirs font partie du domaine national, détenu par l’État. Mais ce sont les élus locaux, réunis au sein d’un conseil rural, qui gèrent les terres de terroir de leur collectivité locale (appelée communauté rurale), sous le contrôle des préfets. Cette gestion se traduit notamment par un pouvoir d’affectation (à ceux qui en font la demande) et de désaffectation (notamment en cas d’absence de mise en valeur) des terres, via une délibération du conseil rural. Les affectations sont gratuites, seuls les frais de bornage sont payés au moment de l’installation, et les affectataires doivent résider dans la communauté rurale. Mais les critères de mise en valeur ne sont définis dans aucun texte et la notion de résidence fait l’objet d’interprétations variées. De fait, les pratiques coutumières persistent et très peu de producteurs disposent d’affectations officielles.
L’actualité sénégalaise a été marquée par différents cas d’attribution de vastes superficies de terres à des investisseurs. L’un d’entre eux — l’attribution de 20 000 ha à une société italo-sénégalaise dans la communauté rurale de Fanaye — a abouti, fin octobre 2010, au décès de 3 personnes et à une vingtaine de blessés.
Alerte précoce et assistance aux populations au Sénégal : le Crafs
Créé en 2010, le Cadre de réflexion et d’action sur le foncier au Sénégal (Crafs) regroupe une trentaine d’OSC et d’OP décidées à pousser l’État vers une réforme foncière participative. Elles développent en ce sens de nombreuses actions : études, mises en débat, plaidoyer, etc. Le Crafs a également mis en place, de façon spontanée, un système d’appui aux populations victimes d’accaparement de terres. Ses principales forces sont le partage rapide d’informations en interne (via une liste électronique de diffusion) et la rapidité d’action. Chacune des organisations membre dispose de contacts privilégiés avec de nombreuses communautés rurales. Si bien qu’elles sont rapidement informées lorsque des paysans sont dépossédés de leurs terres. Le jour même ou le lendemain, au moins l’une d’entre elles se rend sur place, enquête et rend compte aux autres membres. Les actions entreprises varient selon les cas : au niveau local, information des populations sur leurs droits, médiation, appui à l’organisation de « marches », recours à des avocats etc. Aux autres niveaux : interviews dans des quotidiens, utilisation des médias sociaux sur internet, interpellation des autorités, etc.
Cette interview de Mariam Sow, coordinatrice d’Enda Pronat, http://www.endapronat.org, a été réalisée pour Grain de sel par Vincent Basserie du Hub Rural.