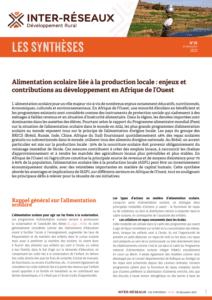Nombre de migrants burkinabè installés en Côte d’Ivoire ont dû fuir lors des troubles fin 2002. Leur retour dans les zones rurales a modifié des équilibres existants. Il a notamment révélé qu’en matière foncière, les principes de l’État et ceux des autorités coutumières cohabitent, parfois dans la plus grande confusion…
AUTREFOIS pôle de stabilité politique et de prospérité économique, la Côte d’Ivoire a été confrontée, à partir des années 90, à des turbulences politico-identitaires qui ont abouti à une rébellion en septembre 2002. Le Burkina Faso a été accusé par les hautes autorités ivoiriennes d’être le « parrain » de la rébellion. Les ressortissants burkinabè ou d’origine burkinabè — de loin la communauté étrangère la plus importante du pays ¹ — ont alors été l’objet de représailles. Ils ont ainsi été contraints de fuir vers le Burkina Faso, où on les qualifia de « rapatriés ». Estimés dans l’ensemble à près de 400000 par le Comité national de secours d’urgence, beaucoup de rapatriés ont choisi les provinces du Houet (24%), du Poni (10 %), la Comoé (4 %) ou le Noumbiel (2 %) alors qu’ils sont principalement originaires du Bulkiemdé (11,7 %), du Sanmatenga (5, 1 %), du Yatenga (4,8%), du Passoré (4,6 %), provinces où la forte pression foncière offre moins de perspective de réinsertion en milieu rural.
Dans les provinces d’accueil, le premier impact de leur arrivée est démographique. Par exemple, la population du département de Niangoloko, dans la province de la Comoé (zone frontalière de la Côte d’Ivoire), est passée de 17069 habitants en 1998 à 30169 habitants en 2004. L’impact est plus marquant lorsqu’il est observé à l’échelle villageoise ; ainsi le village de Bogoté (département de Sidéradougou, province de la Comoé) est passé de 305habitants en 1998 à 1283 en 2004 ; dans la même période, Bossié a vu sa population passer de 654 à 2317 habitants.
En dépit du nombre très important des rapatriés, leur installation s’est réalisée sans problème majeur. Cette facilité s’explique en partie par la mobilisation de réseaux informels excluant de fait l’administration dont l’action a été limitée aux opérations d’identification, d’enregistrement ainsi qu’aux premiers secours à la frontière. Dans les départements, les actions des autorités administratives ont été parfois limitées à la sensibilisation des autorités traditionnelles pour qu’elles facilitent l’accueil « des compatriotes en détresse ».
Le tutorat comme institution d’accueil. Bien avant la rébellion de 2002, la dégradation de la situation des étrangers en Côte d’Ivoire dans les années 90 avait suscité un mouvement de retour. Les migrants d’alors s’étaient orientés vers les zones les moins peuplées en milieu rural (provinces de l’ouest et du sud-ouest), ou dans les centres semi-urbains du Burkina Faso. Ces migrants — ayant laissé, notamment, des investissements dans leurs zones de provenance — y avaient maintenu des contacts. Ils allaient participer à l’accueil des rapatriés après le déclenchement de la rébellion, jouant le rôle de premier tuteur et surtout de courtier auprès des autorités coutumières pour l’obtention des parcelles d’habitation puis des terrains pour l’agriculture. Si le choix des destinations en zone rurale se faisait certes en fonction des disponibilités foncières, il tenait aussi compte des réseau relationnels, au sein desquels se trouvait le tuteur. Les rapatriés étaient ensuite accueillis dans les villages par un notable local qui, en quelque sorte, prenait le relais du premier tuteur. Ce deuxième intermédiaire a pu jouer le rôle de « premier secours », notamment par la prise en charge partielle ou intégrale de ces « étrangers ». Généralement, les rapatriés se sont regroupés en fonction de leurs zones de provenance.
Des dynamiques foncières inédites. Dans leur majorité, les rapatriés se sont installés en zone rurale où le foncier est officiellement régi par l’État. En effet, depuis 1984 l’adoption de la Réorganisation agraire et foncière (Raf), a fait de la terre une propriété exclusive de l’État ². Cependant en milieu rural, cette loi est restée théorique et ignorée de tous les acteurs, y compris des représentants de l’État. Par conséquent, ce sont les règles coutumières qui organisent l’accès à la terre.
Traditionnellement, la terre en milieu rural est un patrimoine collectif inaliénable ; les non-membres de la communauté pouvaient y accéder uniquement par prêt (généralement à durée indéterminée). Si le temps d’exploitation et les superficies n’étaient pas précisés, en revanche la convention était assortie de certaines restrictions (interdiction de planter, d’abattre les essences utilitaires, de prêter à autrui, etc.). Les contreparties exigées portaient essentiellement sur le respect des codes locaux de la sociabilité. Parfois, le versement annuel d’une contribution symbolique (en céréales, et petits animaux) était également exigé. Ces contributions avaient pour rôle de réaffirmer les droits de chacun.
L’arrivée des rapatriés va impulser ou accompagner des innovations, parfois radicales, dans le foncier.
Dans la zone frontalière (Comoé, sud-ouest) également zone de front pionnier, seuls les tout premiers rapatriés ont obtenu les terres selon les modalités traditionnelles. L’importance du flux de migrants entraîna de premières modifications : raccourcissement de la durée, délimitation précise des superficies, augmentation des contreparties et progressivement leur substitution par de l’argent (ainsi, courant 2003, le poulet a été remplacé par la somme de 1000 puis 1500 FCFA et la chèvre par la somme de 4000, 6000 puis 7500 FCFA).
Parallèlement, des ventes de terres ont fait leur apparition. Initialement facturé entre5000 et 7000 FCFA, l’hectare va se négocier entre 20000 et 25000 FCFA à partir du mois d’octobre 2003. Certaines transactions monétarisées sont « mixtes », l’argent étant accompagné de dons de chèvres et de poulets.
Avec l’apparition de la monétarisation, les premiers rapatriés, qui avaient acquis leurs terrains selon les modalités traditionnelles, ont été contraints de renégocier la nature des transactions. Craignant de se voir retirer leurs terres, ils ont, le plus souvent, transformé le prêt traditionnel en achat.
La monétarisation brutale des transactions foncières dans un contexte d’absence d’instances de régulation légale et légitime est source potentielle de conflit. En effet, la notion même de « vente » n’a pas la même signification pour tous.
Pour les rapatriés, l’achat leur confère le droit d’exploiter la terre de façon définitive, avec la possibilité de la revendre en cas de départ. Par contre, pour les autochtones, la vente n’a pas la même signification ³. Ainsi, nombre d’entre eux exigent le maintien des clauses non foncières d’une part et, d’autre part, refusent la formalisation.
Dans les localités où les ventes sont importantes, les transactions sont contestées soit par les autres membres de la famille du vendeur (pour ne pas y avoir été associés), soit par les jeunes autochtones qui y voient une dilapidation du patrimoine foncier, hypothéquant ainsi leur propre avenir. Il est également fréquent de rencontrer des cas de vente d’une seule parcelle à plusieurs acquéreurs.
Face aux incertitudes et à l’instabilité des transactions foncières, les différents usagers utilisent des stratégies diverses pour sécuriser leurs droits en tentant de combiner l’inscription des relations foncières dans le registre socioculturel (respect des normes de sociabilité, respect des clauses de la convention, etc.) et la formalisation.
État-autorités coutumières : une renégociation des rapports. L’accueil et l’installation des rapatriés ont mis en exergue la complexité des rapports entre l’État et les autorités coutumières. Écartés du foncier par la loi, les détenteurs des droits coutumiers considèrent l’État comme un acteur illégitime qu’ils craignent sans pour autant respecter ses prescriptions dans le domaine foncier. D’ailleurs, certaines actions de État sont progressivement remises en cause par les détenteurs des droits coutumiers. Par exemple, les autorités coutumières du village de Folonzo (département de Niangologo) ont profité de l’émotion suscitée par la situation des rapatriés pour les installer dans la forêt classée qui avait amputé le village d’une partie de ses réserves foncières.
L’accueil des rapatriés met en exergue la très forte prégnance des principes coutumiers et le faible ancrage de l’État en milieu rural. En dépit de l’importance de leurs flux, les rapatriés ont pu s’installer et obtenir des terres grâce aux procédures locales. L’évolution des transactions foncières qui en a découlé montre, par contre, les limites du système local, car les innovations se sont réalisées à l’encontre de l’esprit des principes fonciers traditionnels. Les potentialités conflictuelles de ces évolutions résident moins dans leur nature que dans l’absence d’instances légales et légitimes de régulation. Cette situation, qui menace la paix sociale, interpelle l’État dont les lois et textes restent inapplicables, parce qu’ils ne tiennent pas compte des réalités sociologiques du terrain.