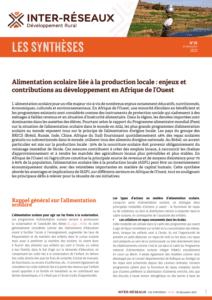Jocelyne Yennenga réagit à l’article « Initiatives et réflexions d’acteurs autour de la vidéo pour le développement » du Grain de sel nº44 : http://www.inter-reseaux.org/revue-grain-de-sel/44-les-organisations/article/initiatives-et-reflexions-d
“Il paraît que pour savoir jusqu’où on peut aller, il faut se lever et marcher”. Jocelyne partage un bout de chemin personnel et des réflexions sur les outils de communication et d’animation en milieu rural. Du vécu et des idées incarnées par le vécu qui ne laisseront pas indifférents les grands marcheurs.
En 2002, je débarquais pour la première fois à Fada N’Gourma, une province de la région Est du Burkina Faso. Je venais de décrocher ma maîtrise en Langues étrangères appliquées aux métiers du tourisme et des affaires à l’Institut des langues étrangères appliquées de Dakar (ILEA) et j’étais revenue au pays pour commencer ma carrière professionnelle. Quelques semaines avant ce « débarquement » à Fada, j’étais très loin d’imaginer que la vie m’amènerait en province. Comme la plupart des jeunes de ma promotion ayant grandi en ville, je rêvais ma carrière dans la capitale. Même Bobo Dioulasso, la seconde ville du pays n’était pas assez moderne dans ma tête de petite fille de cultivateur. Entre mes grands-parents cultivateurs et moi, il y avait un trait d’union qui nous unissait et nous séparait naturellement : mes parents, qui étaient allés à l’école et qui s’étaient retrouvés à travailler en ville.
Une offre d’emploi à la sortie de l’école, une opportunité exceptionnelle de commencer une carrière dans une structure sérieuse et reconnue internationalement. La chance semblait avec moi. Sauf sur un point : le poste qu’on me proposait était en zone rurale. La suite serait intéressante à raconter mais pas dans cet article. Ce qui me paraît plutôt important à partager ici est que, j’y suis restée pendant trois années que je n’ai pas vu passer et qui ont été bien plus que tous les diplômes que j’ai pu avoir avant ou après cette expérience. Pourquoi ?
Tout simplement parce que pour la première fois, j’ai appris à regarder pour voir, à écouter pour entendre, et à me taire pour réfléchir. Pour réussir la mission de responsable du programme de communication que l’on m’avait confiée, je me devais de connaître les destinataires de cette communication. Et qui mieux qu’eux mêmes pouvaient me parler d’eux ? Les techniques et les outils de communication que je connaissais ne prendraient véritablement de sens que s’ils étaient utilisés par les groupes pour lesquels étaient destiné « mon » programme de communication. Si j’avais une large gamme d’outils à mettre à leur service, ils leur revenaient de choisir ceux qui leur convenaient. J’avais autant besoin d’eux pour avancer dans mon travail qu’eux. Ils découvraient le champ des possibles et moi le potentiel à valoriser. « Mes » outils de communication ne prenaient leur sens que si « ils étaient mis au service de… ».
C’est pendant cette période de ma carrière, où j’ai appris à me taire, que s’est passé mon premier contact avec l’outil vidéo. Je demandais sans cesse à mon employeur d’investir dans l’acquisition de cassettes vidéo qui nous serviraient à animer les nombreux ateliers que nous organisions. En effet, aujourd’hui encore, la situation n’a pas beaucoup évolué, les rencontres paysannes d’information ou de formation souffrent beaucoup de l’absence d’outils d’animation et finissent par devenir monotones et peu optimisées.
Pouvoir illustrer un thème par une vidéo permet de le visualiser et de mieux le saisir. Un de mes rêves était de montrer aux paysans des villages où j’allais, des paysans des « pays développés » afin de provoquer des déclics, qui seraient le début de nouvelles initiatives. Mais assez rapidement, mon idée de génie s’est révélée cousue de pièges. D’abord les vidéos sur des thèmes qui pouvaient intéresser les paysans étaient rares. Celles qui venaient de pays lointains étaient trop éloignées de leurs réalités ; enfin, les difficultés logistiques pour gérer des projections en plein air n’étaient pas des moindres. Pour finir, un de mes aînés en communication pour le développement a attiré mon attention sur le fait que les paysans sont souvent distraits par des détails et passent à côté du ou des messages principaux. Fallait trouver, dans cette grande rareté de vidéo, celles qui étaient adaptées au contexte, qui étaient accessibles et qui ne seraient pas « consommées » comme outils de distraction.
Bref, situation inattendue mais pas inintéressante. Et c’est là, que je trouve la vidéo participative comme appropriée dans la communication pour le développement. Les potentialités sont grandes en la matière, tant sur le nombre de sujets qui gagneraient à être traités que sur la richesse du processus et le résultat final que l’on peut obtenir. De mon point de vue, une vidéo, participative ou non, est une vidéo. À priori, seuls les acteurs (les participants et le réalisateur) savent qu’elle a été faite de façon participative.
La production du support en tant que tel ne doit pas être une fin en soi. La mobilisation et le dialogue entre acteurs, leur implication et leur « starisation », la capitalisation de leurs expériences sont des aspects tout aussi importants que le produit final. L’avantage du support en lui-même étant selon moi, la possibilité qu’il donne de diffuser largement une expérience (réussie ou non), de servir de support d’animation, d’introduction, de débat de réflexion, d’être conservé et d’enrichir la gamme de supports existants.
Depuis Fada, j’ai fait un mini bout de chemin. Dans l’atelier de communication que je gère depuis un peu plus de deux ans, nous avons eu l’opportunité de coréaliser une vidéo participative en 2008. Le projet s’est déroulé sans difficultés particulières car en tant que réalisateurs, nous connaissons notre métier, et en tant qu’acteurs, les étuveuses et les coopératives connaissent leur histoire.
Mais la vidéo n’est pas une solution miracle. À mon avis pour réussir une bonne communication, il faut un mélange de médias et de supports de communication. Dans le cadre d’une communication engagée pour le développement, l’équipe technique doit être elle aussi engagée. C’est cette relation entre le technicien et le détenteur de l’expérience à capitaliser qui fait la différence. C’est cette complicité qui peut être à l’origine d’un support ayant une âme et une vie. En plus de la créativité et des moyens financiers, la communication pourra être optimisée s’il existe un réseau de personnes ressources compétentes pour assurer les parties techniques et la diffusion (ne pas négliger Internet qui permet une diffusion à moindre coût).
Un autre point me semble très important : les aspects esthétiques de la vidéo. Une vidéo sur les paysans mérite d’être un support haut de gamme ! Je suis persuadée qu’il ne faut pas chercher à maintenir le rural dans l’archaïque, dans le bas de gamme. Les vidéos sur le monde rural, que ce soit pour sensibiliser, capitaliser ou vulgariser des techniques, doivent être attrayantes. Car un des objectifs de la communication est bien de rehausser l’image du monde rural, et l’image passe par la qualité des supports de communication. Quoi qu’on dise, si toute l’attention se focalise sur la ville et ses lumières, c’est dans les campagnes, à coups de daba, que les paysans font vivre le peuple.
Pour ou contre la vidéo, on ne peut pas nier le pouvoir de l’image sur l’opinion publique. Alors si on veut contrôler son image, il ne faut pas laisser les autres la faire ! Il faut être dans le processus de fabrication de cette image.
Pour finir, je ne peux m’empêcher de faire un autre rêve. Celui qu’une vidéo participative puisse être vue dans des festivals prestigieux de films. Pour cela il faudrait que nous soyons plusieurs à oser ce rêve qui à mon avis n’a rien d’irréalisable. Même si les premiers destinataires sont loin du FESPACO ou de Cannes, c’est lorsqu’on arrivera à s’y rendre que nous serons pris au sérieux. À défaut, on reste entre paysans et on tourne en rond. Les destins du monde rural et du monde urbain sont liés et les outils de communication devraient pouvoir servir aussi de lien. Assez parlée, je me tais !

Les étuveuses de Bama et de Banzon. CTA, Fenop, 2008, 13 min. Performances Communication
Quand la commercialisation du riz passe par sa transformation. Dans la région Ouest du Burkina Faso, à Bama et Banzon, se trouvent deux plaines rizicoles de plus de 2 000 ha, véritables poumons économiques du pays. Auparavant, les sociétés d’État s’occupaient des achats du riz aux producteurs, le transformaient et le commercialisaient. À la fin des années 80, l’État s’est désengagé de la filière et ne s’est plus occupé de la commercialisation du riz paddy. Les producteurs ont alors connu des problèmes de mévente du riz. Découragés, ils ont commencé à abandonner leurs parcelles. C’est à ce moment que les femmes sont entrées en scène en prenant l’initiative d’étuver le riz avant de le vendre.
http://www.inter-reseaux.org/groupes-de-travail/communication-videos/article/burkina-faso-les-etuveuses-de-bama