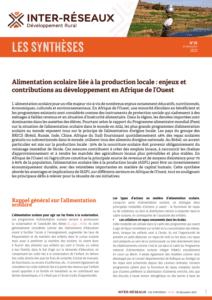« Pénurie de cacao », « un monde sans chocolat », … : les formules lissées par l’industrie chocolatière et les médias exagèrent sans doute les menaces sur le déficit de production. On se demanderait presque s’ils ne rêvent pas à une précipitation de consommateurs crédules sur les linéaires des supermarchés. Ou s’ils ne les préparent pas à une augmentation des prix. Néanmoins, le déficit de production se confirme face à une demande mondiale croissante, et les industriels du chocolat s’inquiètent réellement pour leurs approvisionnements. Ainsi, loin des consommateurs européens, à l’autre bout de la chaine, en Afrique, ils mettent en place des stations pour produire du matériel végétal et des projets dans les villages pour faire augmenter les rendements par hectare. Et ils communiquent sur leurs projets. C’est le grand changement de ce début du XXIe siècle. Pendant des décennies, les industriels se sont désintéressés de l’agriculture familiale pourvoyeuse des fèves de cacao. Quand les grandes plantations du Brésil et de Malaisie s’effondrent vers 1994, la capacité de l’agriculture familiale à résister à des bas prix est redécouverte. L’Industrie du chocolat, impressionnée par le boom café porté par des exploitations familiales du Vietnam, tente d’abord d’y lancer un secteur cacao mais le processus est lent. Un boom cacao ne se décrète pas.
Un intérêt croissant pour les petits producteurs de cacao de Côte d’Ivoire et du Ghana
Les années 2000 sont alors celles d’un intérêt croissant de l’industrie envers les petits producteurs ivoiriens et ghanéens fournissant plus de la moitié d’un marché mondial de 4.000.000 tonnes de fèves. L’appui du secteur privé aux planteurs et à des coopératives, sous forme de projets, constitue une très bonne nouvelle pour les millions de familles vivant du cacao en Afrique de l’Ouest. Ce changement majeur de comportement de l’industrie témoigne en soi d’une reconnaissance de la force de l’agriculture familiale. Certes au service d’intérêts bien compris, ce tournant de géants comme MARS ou CARGILL ou de sociétés de taille moyenne comme CEMOI est à saluer. Les chocolatiers ne sont d’ailleurs pas les seuls à s’intéresser de très près aux planteurs. Les sociétés de produits phytosanitaires avaient commencé avant elles et reviennent en force, suivies par les champions de l’engrais. Paradoxalement, des ONG internationales et/ou agences de certification d’un cacao «respectueux de l’environnement», éthique, comme Rainforest Alliance ou Utz surfent sur les besoins en approvisionnement de l’Industrie et sur cette vague d’un cacao dit durable.
Pour autant, tous les industriels et leurs équipes, ces ONG internationales et agences de certification comprennent-ils bien cette agriculture familiale? En Côte d’Ivoire par exemple, l’industrie évoque des rendements bien faibles, de 300 à 400 kg par ha, qu’elle attribue souvent à un manque de connaissance des paysans. « En formant les planteurs à de meilleures pratiques, il serait possible de faire passer les rendements en Côte d’Ivoire de 400 kg à l’hectare à 800 kg », annonce ainsi un dirigeant d’un géant du broyage des fèves (Le Monde du 22 janvier). Cette expression est représentative de la vision de nombreux cadres de l’agro-industrie et agences de certification : les faibles rendements et la mauvaise qualité du cacao viendraient d’un manque de connaissance des paysans. Il faut leur enseigner de « bonnes pratiques agricoles » pour doubler ou tripler les rendements et améliorer la qualité. Que vaut ce diagnostic justifiant des millions de dollars alloués à la formation et autres « champ école » ?
Mauvaise qualité du cacao ?
Rappelons tout d’abord que la qualité du cacao ivoirien n’est pas « faible ». Elle était bonne jusque dans les années 1980. Elle s’est ensuite dégradée avec la baisse de fertilité des sols, la baisse du prix du cacao puis la libéralisation des achats de cacao à la fin des années 1990, qui a déclenché une course à la fève entre les grands acheteurs internationaux. Les planteurs ont progressivement livré des fèves mal fermentées et séchées à 14% d’humidité au lieu de fèves bien fermentées et séchées à 8% parce que le marché les prenait. Or en théorie, la libéralisation, censée augmenter la concurrence entre acheteurs, aurait dû transmettre les signaux de la demande en faveur d’un cacao de meilleure qualité. Les économistes doivent-ils y voir un «échec du marché » ? Non au sens où les planteurs n’ont fait que s’adapter au marché : la plupart des acheteurs privilégiaient les gros volumes sur la qualité. Mais il y a quand même une forme d’échec dans la mesure où les industriels ont investi dans des unités de séchage et triage fort coûteuses, et dans des programmes de certification pour « former » les planteurs à la qualité.
En 2012, ils se voient presque infligés une leçon d’économie par les politiques publiques avec le retour au prix fixé chaque année par l’Etat, pour un standard défini. A la surprise de tous, cette simple mesure fonctionne. Du jour au lendemain, de l’aveu même du directeur d’une grande compagnie, les usines ne reçoivent plus des fèves à 14% d’humidité mais à 8%. Par quel « miracle » ? Le principe est limpide : avant cette régulation, les exportateurs et usiniers ajustaient leur prix d’achat à la qualité qu’ils mesuraient à l’arrivée du cacao à l’usine. Les acheteurs en brousse appliquaient la même politique. Avec la réforme fixant un prix obligatoire, les acheteurs ne peuvent plus jouer sur le prix en fonction de la qualité. Ils n’ont d’autre choix que de prendre les fèves ou de les refuser au prix fixé. Dès les premiers refus d’achats de mauvaise qualité, les planteurs se remettent à la fermentation, au séchage et au triage du cacao. Dans une large mesure, les investissements des industriels dans le re-séchage ne servent plus puisque les planteurs sont revenus à un cacao à 8% d’humidité.
Des rendements faibles ?
Comme pour la qualité, les rendements ne sont pas si « faibles », même s’ils ont certainement diminué depuis quelques années. De l’aveu même de certains industriels, personne ne connait vraiment les surfaces de plantations, encore moins les rendements. Autrefois, lorsque la quasi-totalité des plantations étaient créées par défrichement de la forêt tropicale, de nombreux planteurs obtenaient des rendements compris entre 800 et 1000 kg/ha pendant quelques années, sans engrais et avec 2 traitements insecticides dans l’année. D’après nos suivis d’exploitations, en 2014 la moyenne en Côte d’Ivoire se situerait plutôt à 500 kg/ha, avec toutefois des différences considérables, avec des rendements compris entre 200 à 1000 kg/ha selon les exploitations.
Si les rendements fléchissent en moyenne, la baisse ne saurait être imputée à un manque de connaissance des planteurs. Il faut en chercher les raisons primordiales dans le changement d’environnement qu’ont connu les producteurs de cacao depuis 20 ans, qui est d’abord un changement écologique : vieillissement des plantations (sauf celles récemment créées en forêts « classées » ou sur des vieilles caféières abandonnées reparties en forêts secondaires), appauvrissement et acidification des sols, maladies et ravageurs. Est également intervenu un changement économique, politique et social : baisse structurelle du cours mondial du cacao, taxe à l’exportation, triplement des prix de l’engrais, et conflits fonciers en amont des crises politico-militaires qui ont traversé par le pays.

Exemple de mortalité des cacaoyers touchés par le virus du swollen shoot (région de Bouaflé)
L’impasse sur le travail et les risques des planteurs
Les planteurs connaissent une grande partie des « bonnes pratiques agricoles ». En ce qui concerne la taille énergique des cacaoyers par exemple, qui est promue dans tous les projets financés par le secteur privé, certains planteurs vont parfois se sentir appuyés, apprendre quelques éléments nouveaux et en bénéficier sur des plantations jeunes, de moins de 20 ans. Mais si les planteurs n’appliquent pas cette pratique autant que le souhaitent les chocolatiers, c’est bien moins par manque de connaissance que parce que la taille des arbres ne constitue pas toujours une si « bonnes pratique » : elle est exigeante en travail (« la taille est un travail qui ne finit jamais ») et surtout porteuse de risques pour les plantations âgées. En effet, une taille peut aggraver la mortalité des vieux cacaoyers en cas de sécheresse (risque accru avec le changement climatique) et de maladie virale comme le swollen shoot.
De même, il est souvent demandé aux planteurs de creuser des fosses dans les plantations de cacao pour enterrer et composter les déchets de cabosses. L’idée est intéressante mais on devrait demander à leurs promoteurs de creuser eux-mêmes les fosses dans les sols caillouteux, pour qu’ils réalisent la quantité de travail imposée. Il est aussi demandé aux planteurs de respecter toute la biodiversité dans leurs plantations, jusqu’aux insectes tels que les termites, qui dévorent pourtant les jeunes cacaoyers et constituent une des principales causes de l’échec de la replantation cacaoyère. On devrait aussi envoyer certains conseillers grimper dans les cacaoyers pour éliminer les Loranthus (un épiphyte du cacaoyer) et tester leur résistance physique et psychologique aux fourmis rouges, en équilibre à 3 mètres de hauteur : cette « bonne pratique agricole » est importante mais dangereuse. Finalement, en négligeant le travail et les risques associés aux pratiques qu’ils recommandent, certains représentants de l’agro-industrie et ONG internationales certifiant un « cacao écologique et éthique» ne sont-ils pas moins rationnels que les planteurs veillant sur leurs cacaoyers (leur principal capital et patrimoine) et sur leur propre santé ?


Un planteur luttant contre le Loranthus
La replantation cacaoyère sur des sols dégradés est sujette à de multiples cas de mortalité. Les grandes compagnies et projets qui diffusent du matériel végétal sélectionné semblent ignorer les taux d’échecs, qui sont considérables : nous avons visité des projets où le taux d’échec de replantation avoisinait 90%. Pour réussir, les planteurs doivent souvent recommencer 2 ou 3 ans de suite. La replantation cacaoyère n’est plus un investissement mais une loterie, disent les planteurs. Ils échouent d’ailleurs moins avec leur propre matériel végétal, issu de leurs plantations, et avec leurs propres techniques, qu’ils adaptent et inventent eux-mêmes. L’agro-industrie ne devrait-elle pas s’intéresser au moins autant à ces innovations des planteurs qu’au matériel végétal dit sélectionné? Sur ce point, la recherche agronomique nationale ne pourra pas éviter de se remettre en question.
Les planteurs réagissent et diversifient
A force d’échecs répétés, les planteurs diversifient vers des cultures supportant mieux ces nouvelles conditions écologiques, tel l’hévéa. Certains migrants repartent en savane planter des anacardiers. Hommes, femmes et enfants se croisent aussi sur les pistes, avec un matériel de fortune pour extraire de l’or. Certains ont la sagesse de réinvestir dans des achats ou locations de parcelles pour maintenir un minimum de cultures vivrières, d’autres saisissent l’occasion de la pisciculture, pour peu qu’ils aient la chance de bénéficier d’un projet local. Les « petits producteurs » sont aussi des consommateurs, des chefs de famille devant nourrir souvent 10 à 20 personnes. La force de travail et l’innovation passent aussi par leur sécurité alimentaire.
Champs école, fantasme collectiviste et récitation
En 2013/14, la chute du prix du caoutchouc et le ralentissement des achats dans ce secteur vont peut-être faire plus pour le cacao que tous les milliers de « champs école » existants mais souvent peu suivis par les planteurs.
Loin de leur image, ces champs école développent rarement une approche participative et ressemblent plus à des cours délivrés à des planteurs supposés ne rien savoir et tout apprendre. L’erreur de fond est de délivrer un « enseignement » très général alors que chaque plantation a ses propres particularités et ses propres défauts. De même chaque planteur a ses propres contraintes et ses critères pour gérer son exploitation. Au lieu de les éclairer sur des choix possibles, en constituant une aide à la décision, le « champ école » est encore trop souvent un ensemble de préceptes figés. Le « champ école cacao» et leurs concepteurs semblent également tout ignorer de la psychologie d’une majorité de planteurs, très loin de l’idéologie de « travail en groupe » qui leur est imposée. Surprise, comme la plupart d’entre nous, bien des paysans sont individualistes. Là aussi, quand on voit les difficultés qu’ont les cadres des compagnies privées à travailler vraiment ensemble, chacun ayant mis en place son propre projet, il est presque amusant de les voir penser « collectivité » pour des planteurs qui n’en veulent pas plus.
Interrogés au village, nombreux sont les planteurs récitant sagement ce que leur coopérative ou leur « PR » (« Paysan relais ») leur enjoint de dire, à la gloire des champs école et de la certification. Mais si l’on va au plus profonds des plantations, à l’abri des regards et des oreilles, les discours de certains planteurs changent : « Je vais au champ école 2 ou 3 fois par an, juste pour me tenir au courant de tout avantage éventuel apporté par la coopérative » (l’espoir d’un don de matériel végétal ou de produit par la coopérative, un accès au crédit pour les intrants, ou pour une urgence familiale si la coopérative est suffisamment bien organisée). Certes, il peut y avoir des exceptions et des évolutions. Certaines formations peuvent être de meilleure qualité sur le fond et sur la forme pédagogique. Chaque société privée cherche plus ou moins à créer son propre « business model » et l’un d’entre eux finira peut-être par s’imposer, à moins qu’il ne soit finalement inventé par les planteurs eux-mêmes ou par leurs enfants.
Mais la priorité agro-économique No 1 du secteur cacao n’est pas la formation, encore moins une formation collective de type « champ école ». C’est une réponse concrète à l’usure des sols et du milieu naturel. La forêt ayant disparu, l’engrais – minéral ou biologique, probablement une combinaison des deux – ainsi que des moyens de lutte diversifiés contre les maladies et ravageurs deviennent incontournables.
En Côte d’Ivoire, il s’agit notamment de comprendre la chute des achats d’engrais depuis le pic de 2003. Pour une large part, elle est liée au déclin du prix du cacao et la hausse brutale des prix des engrais (Fig.1). D’autres facteurs interviennent, invitant à poursuivre les recherches, mais une hausse du prix du cacao et une baisse du prix de l’engrais feraient beaucoup plus pour la réhabilitation des cacaoyères et la remontée des rendements que tous les conseils prodigués à travers des projets ou schémas de certification. Du moins, hausse du prix du cacao et baisse du prix des engrais sont des préalables à la « formation ». Même à un niveau encore insuffisant, le prix au producteur, à nouveau fixé par les pouvoirs publics à chaque début de campagne, réduit les aléas et crée déjà un environnement plus favorable aux investissements et à la prise de risque par les planteurs.

Sources : Observatoire 80 exploitations cacaoyères de Soubré. 1997-2011
La priorité des actions de soutien agro-économique est donc celle de l’aide à l’investissement dans la régénération des sols et des arbres, par la fertilisation, la lutte contre les ravageurs, et la replantation, en interaction avec les savoirs paysans. Une partie de l’industrie chocolatière a perdu du temps en n’y venant que très récemment et elle sous-estime encore les capacités d’innovation des planteurs.
La fertilisation des cacaoyers : chimique et biologique
A la fin des années 1980, alors que l’industrie du chocolat ne jouait encore aucun rôle dans la vulgarisation agricole et que la société publique d’appui aux planteurs de cacao, la SATMACI, s’était désintégrée faute de ressources, c’est grâce au dynamisme et à la capacité d’innovation de l’agriculture familiale en Côte d’Ivoire que l’engrais chimique est testé puis adopté dans les cacaoyères. L’utilisation de l’engrais cacao est ainsi initiée par des planteurs baoulé (migrants du centre du pays), avec des techniques d’application qu’ils ont eux-mêmes inventées. C’est grâce à eux et à l’émergence d’un secteur informel de marchands d’intrants que le déclin du cacao a pu être évité dans la région de Soubré, la fameuse boucle du cacao du pays, du moins jusqu’à ces dernières années.
Aujourd’hui, alors que l’industrie du cacao démarre des programmes de soutien à l’achat d’engrais chimique, les planteurs, fils de planteurs, acheteurs, pisteurs, s’y intéressent et en profitent. Mais ils organisent également des réseaux de distribution de fiente de poulet, depuis les élevages de volailles jusqu’aux plantations de cacao. En complément aux engrais chimiques, ils savent mieux que les chocolatiers que le salut de leur exploitation passe par différentes formes de fertilisation, y compris biologique. Des dépôts de fumier de poulet se mettent ainsi peu à peu en place à l’entrée des villages, en bordure de route ou piste. Les planteurs innovent aussi en commençant à récupérer du fumier de mouton, des résidus agricoles tels que le son de riz. Ces initiatives ne coûtent pas un seul Fcfa, ni aux industriels ni à l’Etat. Or personne dans l’industrie ou les institutions publiques ne les considère et n’en fait l’évaluation. Pire, certains les condamnent sans les évaluer.
En résumé, la non-application de nombreuses « bonnes pratiques agricoles » venues « d’en haut » dans le secteur cacao relève d’un choix rationnel des planteurs, prenant en compte la demande du marché, la dégradation des sols, la multiplication des maladies et des ravageurs, les surfaces et l’âge des plantations, la contrainte sur le travail, les coûts et retours d’investissements, les risques sur le capital productif et sur leur propre vie : les principes mêmes de tout bon entrepreneur.
Les planteurs connaissent leur métier et leurs priorités. Ils sont même parfois en avance sur l’agro-industrie dont ils attendent plus de soutien, non pas sur la formation mais sur les prix et la recapitalisation des sols, sans idéologie a priori sur les modes de fertilisation.
L’écorce des cacaoyers, « comme passée à l’eau bouillante »
Si besoin de formation il y a, il s’agit d’un appui pour l’identification des ravageurs et maladies qui se multiplient et s’aggravent, ainsi que sur les produits et techniques qui permettraient de les combattre. Encore faut-il mettre en place un système de veille des maladies, quasi-inexistant. Depuis des mois en Côte d’Ivoire, des milliers de planteurs s’alarment d’une maladie qui donne l’impression que « l’écorce des arbres a été passée à l’eau bouillante». Ni l’agro-industrie ni la recherche nationale ne semblent en mesure de répondre à leurs inquiétudes.
Il s’avère enfin essentiel de protéger les planteurs contre les multiples contrefaçons et arnaques sur les produits phytosanitaires et engrais. Les planteurs attendent certes un appui sur les intrants et les services, mais sans avoir à se surendetté pour cela. Ils ont grand besoin d’appui sur le renouvellement des vergers et la recapitalisation des exploitations familiales, mais en intégrant leur propre savoir-faire. On revient donc bien à la question du prix du cacao, qui tarde à remonter malgré la « pénurie » annoncée.
Francois Ruf est chercheur économiste au CIRAD (UMR Innovation)
Marion Bourgeois est étudiante à SUPAGRO