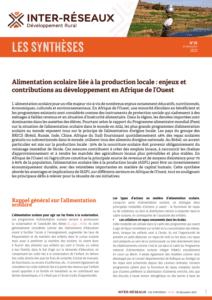Premier ministre de République centrafricaine (RCA) de juin 1996 à janvier 1997, Jean-Paul Ngoupandé nous donne aujourd’hui sa vision de l’avenir de l’Afrique et de la RCA au lendemain de l’Indépendance, vision teintée d’espoir grâce notamment au rôle à jouer de l’agriculture.
Grain de sel : Pouvez-vous nous rappeler les actions que vous avez menées lors de votre mandat et votre parcours jusqu’à aujourd’hui ?
Jean-Paul Ngoupandé : Je suis philosophe de formation. J’ai commencé ma carrière professionnelle dans mon pays en 1980, comme professeur à la faculté des lettres et sciences humaines de Bangui, puis doyen de cet établissement. Puis, en septembre 1985, j’ai été nommé ministre de l’Éducation. Ensuite, j’ai passé sept années en diplomatie, comme ambassadeur en Côte d’Ivoire (de 1989 à 1994) puis en France (de 1994 à 1996). En juin 1996, suite aux mutineries au sein de l’armée centrafricaine, qui ont secoué le régime du président Ange-Félix Patassé et mis à mal l’unité du pays, j’ai été appelé pour diriger un gouvernement d’union nationale (GUN) dont la mission était de ramener la paix et la concorde, de tenter de résoudre la crise de l’armée et renouer avec les partenaires au développement par des réformes économiques hardies. Cette mission était inscrite dans un « Protocole d’Accord Politique » signé par tous les protagonistes de la crise. L’expérience a duré à peine huit mois, du fait des blocages et des tensions de toutes sortes, notamment avec le camp présidentiel. Après cette expérience, j’ai clairement pris position. Je suis rentré véritablement en politique partisane et je suis devenu leader de l’un des partis du pays. Je le suis toujours d’ailleurs… J’ai été élu député en 1998, et réélu en 2005. Puis, après le changement de 2003 et les élections de 2005, je suis entré à nouveau au gouvernement comme ministre d’État aux Affaires étrangères. Enfin, un grave problème de santé m’a contraint à suspendre mes activités politiques et professionnelles. Je vais mieux à présent..
GDS : Vous avez écrit plusieurs essais ( notamment “L’Afrique sans la France”, “L’Afrique face à l’Islam”), ainsi que des articles remarqués dans la presse parisienne (“L’impossible unité africaine”, “L’Afrique suicidaire”, etc.). Des titres plutôt pessimistes. Pourquoi ?
JPN : Ces ouvrages sont tout simplement le constat à un moment donné d’une situation qu’il faut changer. Je ne suis pas du tout afro-pessimiste ! Ces titres forts, comme « L’Afrique suicidaire », c’est juste une façon de dire qu’il faut que nous reprenions le bon chemin. Et les titres sont souvent une affaire d’éditeur, c’est-à-dire une affaire, disons… un peu commerciale ! Je pense, au fond, que les Africains doivent être les premiers à reconnaître les choses qui ne vont pas. Aujourd’hui, il y a un discours de responsabilité à tenir. Le temps est venu de reconnaître que nous sommes responsables d’une partie de nos problèmes actuels. Je lutte contre l’afro-pessimisme car entre l’afro-pessimisme et le racisme, il n’y a qu’un pas. L’afro-pessimisme radical signifie que la situation est sans espoir, que l’Afrique noire est en marge, voire hors jeu, de la civilisation et de la mondialisation. Un tel discours mène en réalité vers une approche raciste. C’est cela qui a piégé un peu l’Occident aujourd’hui, lequel a du mal à admettre que l’émergence de pays comme la Chine conduit à la réintégration de l’Afrique dans le jeu de la mondialisation, du fait de l’intérêt que le géant asiatique porte à notre continent.
GDS : Êtes-vous donc les seuls responsables de la situation actuelle en Afrique ?
JPN : Depuis les dernières décennies, celles qui ont suivi l’indépendance, nous sommes en effet les principaux responsables. Mais il est évident que la responsabilité extérieure a été excessivement lourde pendant trois à quatre siècles. La plus terrible responsabilité portée par l’extérieur débuta avec le plus grand drame que l’Afrique contemporaine ait connu : la traite négrière. Quand vous l’étudiez en profondeur et non de manière superficielle, vous constatez que des séquelles et des traumatismes subsistent à tous points de vue. Puis, il y a eu la colonisation. Elle avait ses mauvais côtés, bien sûr, mais a pu tout de même, sans être une œuvre de philanthropie, apporter une certaine modernité. Depuis, nous sommes indépendants, notre part de responsabilité ne fait que croître. Le poids de l’extérieur reste présent mais c’est à nous de prendre l’essentiel des décisions.
GDS : Quelle est votre vision de l’avenir de l’Afrique ?
JPN : Aujourd’hui, les Occidentaux se trompent complètement. L’Afrique est un continent qui bouge de manière saisissante. Elle est à un véritable tournant. Elle continue certes d’être confrontée à d’énormes défis : la mal-gouvernance, la déliquescence des Etats, la persistance de quelques conflits internes meurtriers, la non-maîtrise de sa démographie, des crises éducatives et sanitaires aiguës, des risques écologiques, notamment l’avancée de la désertification, etc. Mais elle dispose aussi d’atouts considérables. Le bouleversement induit par la montée en puissance de nouveaux pays émergents, comme la Chine, l’Inde, le Brésil, etc., nous offre une chance en nous permettant une variété d’offres de partenariat, ce que nous n’avions pas du tout il y a une décennie. Il faut saisir cette chance. L’horizon paraissait bouché jusqu’à il y a dix ans. Aujourd’hui, je regarde l’Afrique avec plus d’espoir. Je mesure l’importance des défis mais je tiens compte aussi de nos potentialités et des opportunités. En ce qui concerne les processus de démocratisation, nous sommes toujours dans la période de transition qui a commencé avec la chute du mur de Berlin. Il y a eu et il y aura des hauts et des bas, ce qui me paraît normal. Cela prendra encore quelques années, mais il y aura de plus en plus de pays qui se stabiliseront. Viendra un moment où une masse critique de pays stables entraînera la machine. Je souhaite que l’Afrique, qui a inventé l’agriculture, redevienne une grande terre d’agriculture.
GDS : Dans L’Afrique sans la France, vous faîtes le constat de l’échec de l’agriculture africaine. Selon vous, échec dû aux « troubles naturels » (aléas climatiques, guerres civiles), mais aussi dû à l’exode rural et à l’inadaptation des systèmes éducatifs. Pouvez-vous nous exposer votre vision de l’agriculture en République centrafricaine ?
JPN : Avant toute chose, je réaffirme qu’en 1960, nous avons manqué le rendez-vous du développement agricole. Il faut savoir que la Chine est partie avec une priorité accordée depuis 1949 à l’agriculture comme base de développement. En ce qui nous concerne, il faut quand même bien reconnaître que nous avons été piégés par une économie agricole coloniale qui était une économie de traite. Les grandes cultures de l’Afrique francophone (les 3 C : coton, café, cacao) n’étaient pas destinées à la consommation locale mais à l’exportation. Elles n’ont pas été introduites de manière locale mais imposées de l’extérieur pour les besoins des métropoles. Le plus grand dérapage, au-delà des problèmes cités auparavant (aléas climatiques, exode rural), est le manque d’effort pour sortir du piège de l’agriculture de traite, qui a eu ses heures de gloire, en particulier en Côte d’Ivoire dans les années 60 et 70. Mais il aurait fallu que, de manière très volontaire, on choisisse de relancer d’autres cultures correspondant prioritairement aux besoins locaux. Par exemple, le début d’industrialisation avec le coton s’est fait uniquement avec les usines d’égrenage. Ça s’est arrêté à ce stade car les efforts de développement d’une industrie textile ont échoué du fait de la très faible compétitivité. En réalité, les quelques usines textile qui ont commencé à voir le jour ont disparu. Le constat de René Dumont dans « L’Afrique noire est mal partie » résume très bien la situation et est plus que jamais d’actualité. Nous avons manqué le rendez-vous du développement agricole mais il n’est jamais trop tard. Nous savons ce qui n’a pas fonctionné. En ce qui concerne la volonté politique, il suffit de dérouler le contenu, la répartition des budgets de l’État en général et vous vous rendez compte que la part consacrée au développement rural, malgré toutes les proclamations, est minime. La RCA est le cas typique du pays dont l’agriculture a des atouts réels. De ce côté, je dois dire objectivement que la colonisation française, malgré son orientation vers les produits de rente, a engagé de gros efforts de formation et de recherche. Le nombre de centres de recherche agronomique réalisés pendant la période coloniale est assez impressionnant. Un maillage qui, certes, était destiné à répondre aux besoins de la métropole, mais ces centres étaient tout de même dans le pays ! Par exemple, à Boukoko, dans le sud-ouest centrafricain, à une centaine de kilomètres de Bangui, un grand centre de recherche agronomique regroupait de très bons chercheurs français. C’est là qu’a été mis au point le mélange d’arabica et de robusta, pour donner l’arabusta, par l’équipe du professeur Sakas. Dans l’élevage, des centres de multiplication ont commencé à initier très tôt les croisements permettant d’adapter des races bovines. Malheureusement, cette tendance s’est brutalement arrêtée avec la « réforme agraire » de Bokassa au début des années 70. Certains des chercheurs sont partis de chez nous pour la Côte d’Ivoire, pour y continuer leur travail de recherche. Bokassa a commencé par être un bon président pour l’agriculture centrafricaine (1966-1970) avant d’en devenir le premier fossoyeur. Au début de son règne, de gros efforts ont été faits pour maintenir les acquis et augmenter la production (coton, café et vivriers notamment), mais en 1971, la fameuse réforme agraire a tout détruit et nous continuons d’en payer les conséquences aujourd’hui. La situation actuelle de l’agriculture est surtout caractérisée par le fait que les principales régions de production sont touchées par l’insécurité, illustrée par exemple par les violences dans le nord-ouest du pays.
GDS : Quelles sont les principales difficultés des agriculteurs centrafricains ?
JPN : Tout d’abord, il est difficile de cultiver dans des zones troublées par l’insécurité chronique. La seconde difficulté est l’état du réseau routier car pour que l’agriculture soit une activité économiquement attrayante, il faut que le producteur puisse avoir accès aux consommateurs, c’est-à-dire aux grands marchés urbains. Cela suppose d’avoir la possibilité d’évacuer les produits rapidement sur ces marchés urbains. Cela suppose donc des routes en bon état et sécurisées. La croissance de la population urbaine a pour conséquence une concentration des pôles de consommation dans les villes. Puis il y a le problème de l’encadrement. Les réussites durant les premières années de l’Indépendance résultaient d’un bon encadrement, proche de la population rurale. Le ministère du Développement rural à l’époque était présent dans les villages et encadrait les paysans pendant la période de production de coton. Pendant longtemps, le coton a été la principale production. Le coton en Afrique francophone a été introduit chez nous dans les années 20, par un administrateur colonial guyanais nommé Félix Eboué. Pendant de nombreuses années, nous avons été la colonie qui produisait le plus de coton. Nous avons atteint près de 70 000 tonnes pour la campagne de 1969-1970. Depuis au moins deux décennies, nous n’avons fait que décliner, avec nos problèmes politiques. Dans les régions cotonnières, qui rassemblent un tiers des paysans centrafricains, les cultures vivrières accompagnent le coton. Le sol utilisé pour la production du coton bénéficie d’engrais et sert ensuite pour les vivriers (manioc, maïs, arachide, etc.). La crise de la production du coton se ressent donc sur la production vivrière. Enfin, la mondialisation ne permet plus une agriculture figée. Il faut être à l’écoute du marché, ce à quoi les méthodes culturales traditionnelles et le manque de formation des paysans ne peuvent permettre de répondre.
GDS : Selon vous, quel rôle doit jouer l’Etat pour améliorer la situation agricole de la RCA ?
JPN : L’État doit, en premier lieu, garantir la sécurité de l’activité rurale. Son second rôle est la formation. L’agriculture traditionnelle est une agriculture d’autosubsistance. L’État doit insérer nos agriculteurs dans la mondialisation et les former pour qu’ils soient à l’écoute du marché, capables de moderniser leur gestion et de raisonner en termes de vente pour dégager des gains. Il y a quelques années, en passant dans un village, j’ai vu un paysan dans son petit champ de manioc. Je lui ai demandé pourquoi il n’étendait pas son champ puisque la place était libre. Sa réponse a été nette : « Non, ce n’est pas la peine, c’est suffisant pour nous nourrir, ma femme, mes enfants et moi. ». C’est cette mentalité d’autosubsistance qu’il faut faire évoluer, et pas par des discours. Il faut que les agriculteurs y trouvent leur intérêt, qu’ils comprennent que le profit dégagé permet d’améliorer leur vie. Dans un rayon de 100 km autour de Bangui, on constate déjà un début d’évolution vers le nouveau type de paysans que nous attendons. Tout ce qu’ils cultivent est vendu grâce à la proximité de la capitale et aux routes bitumées qui y conduisent. Des petits paysans ont déjà quitté la campagne pour s’installer à 80 km de Bangui et ont accru leurs revenus monétaires. Finalement, quand les producteurs ont la possibilité de vendre, ils prennent conscience de la possibilité d’améliorer leurs conditions de vie, et on n’a plus besoin de les motiver pour faire des gains. Mais plus on s’éloigne des villes, plus on se rapproche de l’agriculture d’autosubsistance. L’État doit donc faire des choix stratégiques. Certains préconisent le retour à la formule de fermes d’État qu’on a connues à une certaine période. Je doute de leur efficacité, vu la manière dont sont gérées les entreprises publiques. Par contre, je crois à la formation. Si elle est faite en sorte que les ingénieurs agronomes se retrouvent capables, sur le terrain, de se mettre à leur compte, alors le visage de l’agriculture changera. En tant qu’enseignant et ancien ministre de l’Éducation, je suis évidemment conscient du problème du contenu de la formation. L’Institut supérieur de développement rural (ISDR) a certes formé des ingénieurs. D’autres ont été formés à l’étranger, notamment en France. Mais le ministre du Développement rural me donnait, il y a quelques années, les statistiques selon lesquelles 80 % des ingénieurs agronomes se retrouvent à Bangui et « se tournent les pouces » au ministère. Il n’y a pas de problème foncier. Nous sommes en effet à peine 4 millions d’habitants pour 623 000 km2 de territoire non désertique : une partie en forêt équatoriale, une partie en savane boisée, une petite partie au nord-est en savane moins boisée et tendant vers le Sahel. Bien sûr, les démarches administratives sont toujours un inconvénient, mais avoir un terrain en RCA n’est pas difficile. Créer sa ferme n’est pas un problème. Mais un ensemble de choses contrarie : la politique, l’insécurité, l’instabilité, la mentalité. Pour l’agriculture, comme pour d’autres secteurs, le problème réside aussi dans le manque de possibilités bancaires. L’expérience de banque de développement rural a été un échec : Les emprunteurs n’étaient pas des agriculteurs mais des urbains, c’est-à-dire des hauts fonctionnaires, des ministres, qui utilisaient les crédits pour d’autres besoins que l’agriculture (consommation) et ne les remboursaient pas. Tant qu’on ne la financera pas via les circuits bancaires, l’agriculture ne se développera pas.
GDS : Quelles sont les marges de manœuvre de la politique agricole nationale quand on sait que la RCA s’inscrit dans les pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) ?
JPN : Osons penser l’avenir autrement. Aujourd’hui, il est impossible de conduire une véritable politique agricole nationale au sein de chaque État. Le marché nous impose d’adopter une politique agricole sous-régionale car il y a un besoin de complémentarité. Nous devons réellement mettre en place une stratégie communautaire de développement agricole. Les six pays de la Cemac (Cameroun, Centrafrique, Congo-Brazzaville, Gabon, Guinée-Equatoriale et Tchad) sont complémentaires. Trois d’entre eux (Tchad, RCA, Cameroun) ont des potentialités naturelles pour le développement de l’élevage, tandis que le Gabon, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale mais aussi le sud du Cameroun et de la RCA peuvent développer la sylviculture. L’eau est aussi une denrée très abondante dans la Cemac. Le bassin du Congo est le second plus grand au monde après l’Amazone. Et les micro-barrages sont un moyen de développer l’agriculture. Mais cela exige évidemment une mise en synergie des volontés politiques, des stratégies de développement et des infrastructures. Au final, le sol africain bénéficie de nombreuses ressources mais manque d’organisation. Je plaide pour une stratégie communautaire. Si, déjà, la Cemac, avec ses 35 millions d’habitants, pouvait mettre en place une stratégie commune, ce serait mieux que chaque pays pris isolément. Pour le moment, j’ai l’impression que la stratégie communautaire est plus axée sur les aspects commerciaux que sur la production elle-même. Bien entendu, il faut intégrer l’aspect commercial. Nous savons qu’en termes douaniers, c’est un espace intégré. Mais en termes économiques, il faut aussi faire jouer les complémentarités. Aujourd’hui, certains des pays de la Cemac ont les potentialités pour développer telle ou telle activité. Il faut que la communauté cible et investisse dans chacune des différentes productions au lieu de créer des concurrences inutiles.
GDS : Vous êtes très favorable au développement du secteur agricole mais ne pensez-vous pas qu’il ne faut pas délaisser le tissu industriel, quasi inexistant en RCA, contrairement au Cameroun par exemple ?
JPN : Je crois beaucoup en l’agriculture. Malgré la rentabilité à court terme de l’économie minière, si on ne parvient pas à une parfaite maîtrise d’une politique de développement agricole, cela restera aléatoire car il y a d’abord un besoin de nourrir la population. Le développement agricole doit pouvoir servir de rampe de lancement pour l’industrialisation, comme on a pu le voir dans de nombreux pays développés. La croissance rapide de la population entraîne une forte demande alimentaire. La question du pouvoir d’achat en Afrique francophone s’est brutalement posée ces dernières semaines, avec les manifestations violentes qui ont eu lieu au Burkina Faso et au Cameroun. Les revendications, notamment salariales, sont certes légitimes. Mais on constate que dans beaucoup de pays de la zone franc, l’une des causes récurrentes de la cherté de la vie est la faiblesse de l’offre en produits vivriers. Sans un effort considérable sur le chapitre incontournable de l’alimentation, en termes d’augmentation de la production, l’amélioration du pouvoir d’achat est et sera illusoire. Quand je dirigeais le gouvernement de la RCA, j’ai constaté que le salaire moyen du fonctionnaire centrafricain n’était pas parmi les plus faibles du monde. Bien sûr, depuis, le problème de la régularité du versement de salaires s’est aggravé. Mais quand je décomposais les dépenses moyennes du fonctionnaire, je constatais la part incroyablement élevée consacrée à l’alimentation, qui pouvait atteindre 60 à 80 % ! Quand un tel pourcentage est attribué à l’alimentation et que vous disposez de 100 000 francs CFA , que reste t-il pour le logement et le reste ? Or, l’une des meilleures façons de régler ce problème de pouvoir d’achat, est de satisfaire abondamment l’offre vivrière. Quand le prix de la viande monte comme aujourd’hui avec la crise que connaît l’élevage dans mon pays, c’est évidemment intenable. Dans la partie sud de la Centrafrique, la saison des pluies est plus longue, et quand on remonte au nord, elle est plus équilibrée (6 mois sur 12). Traditionnellement, comment cela se structure-t-il ? Dans la vie traditionnelle du village, la saison des pluies est la saison des cultures, des plantations, des récoltes. La saison sèche correspond à d’autres activités : la chasse, la pêche. Aujourd’hui, les moyens techniques permettent de contourner les contraintes saisonnières, ne serait-ce que par la possibilité de l’irrigation. Par exemple, le Burkina Faso s’essaie à l’irrigation et peut faire deux ou même trois récoltes annuelles de certains produits (maïs, riz). Les perspectives de développement agricole sont évidemment bonnes aujourd’hui : l’argent que nous gagnons rapidement grâce au boom de l’économie minière peut être investi dans le créneau durable qu’est l’agriculture, pour la formation, la recherche, l’équipement et l’amélioration des infrastructures. Je suis pour le développement agricole car c’est la première voie pour développer l’industrialisation, par la transformation des produits agricoles. Lorsque nous arriverons à transformer le manioc, afin de le manger autrement que nos aïeux, alors ce sera le départ de l’industrialisation. J’ai l’habitude de dire que nous avons copié beaucoup de choses chez les français mais nous avons oublié de copier ce qu’ils ont certainement accompli de plus remarquable dans leur histoire économique : leur agriculture, qui demeure l’une des plus performantes et des plus riches au monde. La France a su bâtir au fil des siècles un savoir-faire remarquable de ses paysans.
GDS : Existe-t-il un nom concret pour la politique agricole menée au niveau national ?
JPN : Après l’Indépendance, le Président David Dacko avait donné comme nom « Kwa ti Kodro » (« le travail du pays »). Bokassa est arrivé en 1966 et c’est devenu « Opération Bokassa ». Après, on leur a donné d’autres noms mais le plus important est de revenir à la réalité, plus au contenu qu’à la désignation.
GDS : Comment définissez-vous une bonne politique agricole, une politique agricole viable ?
JPN : C’est celle qui joue plus sur la qualité des hommes et sur leur inventivité que sur les décisions administratives. C’est-à-dire qu’il faut évoluer vers une responsabilisation des hommes. Le passage du cultivateur à l’agriculteur est pour moi la meilleure définition de la révolution agricole. Le cultivateur, c’est l’habitude, la tradition, l’autosubsistance, la routine rythmée par les saisons. L’agriculteur, c’est le producteur moderne, qui pense en termes d’amélioration de la production, d’adaptation au marché, de gestion rationnelle et de profit.
Entretien réalisé par Amandine Marie, à Paris, le 14 mars 2008.